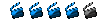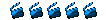Gummo de Harmony Korine (1997) - 8/10

Harmony Korine est une sorte d’avorton, un cinéaste peu orthodoxe qui se moque bien des codes de son art, et qui voue un culte pour les marginaux qui peuplent les rives d’une Amérique crasseuse. Il filme ses semblables, il se filme lui-même, se réapproprie leur malaise. Harmony Korine vient de Nashville. A travers Gummo, sa misère white trash, cette parodie de liberté, cette ville fantôme dévastée par une tornade dans l’Ohio, cette déliquescence de l’adolescence, l’absence d’avenir chez les rednecks, le réalisateur pose son regard à la fois empathique et amusé, celui d’un portraitiste qui aime s’accaparer le monstrueux. Gummo, mosaïque hybride de gueules cassées, de destins brisés, de railleries assumées, aurait pu devenir un énième ersatz filmique chez les bouseux.
Sauf que le scénariste de Kids, impose sa griffe, se rapproche de ces jeunes pour les écouter au creux de l’oreille et singe son long métrage qui immigre vers le documentaire voyeuriste et le conte horrifique à la fiction désordonnée où les errances des teenage movie de Larry Clark et de Gus Van Sant ne sont jamais bien loin. Harmony Korine n’a pas la prétention d’écrire un pamphlet anti système, ni même d’énoncer un avis critique, d’avoir des choses à dire sur le comportement d’une communauté obscurcie par la fatalité. De ce fait, Harmony Korine abandonne l’idée de structurer son œuvre, oublie l’essence même d’un récit linéaire classique pour faire de Gummo, une collection de fortunes sur l'existence sombre d'un quartier pauvre. Ce qui le différencie de ses influences, notamment de Larry Clark, c’est d’accoucher d’un ordre moins pré établi, d’élargir son champ lexical cinématographique, pour en dissocier la sève, et de ne pas se contenter d’énumérer la sécheresse explicite de la réalité.
Par sa capacité à se jouer des images, à coller les éléments visuels dans la volonté de créer un aggloméra disjoint de formats et de polaroids instantanés à la Godard (voix off, ralenti érotique sur Chloé Sevigny, super 8 etc…), Harmony Korine, avec son rire farceur, et son humour graveleux, adopte sa propre posture absurde, dévoile un univers presque intemporel, un espace clos isolé de toute règle, un conte horrifique où les princesses attardées se prostituent, où les jeunes adolescents se travestissent en cachète, où un garçon « lapin » erre sans voix, coincé dans une cage comme métaphore de son impuissance à s’élever et où les lutins, les elfes tuent les chats pour finir par se la « coller » dans des bad trip. Porté par un souffle, un cœur qui bat à rebours, Gummo s’éloigne du réalisme, de ce cinéma vérité que prône par exemple le récent The Other Side de Roberto Minervini, pour s’émanciper dans les contrées du surréalisme (ce qu’il fera avec le non moins magnifique Spring Breakers), qui diffère du premier degré, d’un sérieux plombant. Le pathétique, Harmony Korine ne le filtre pas, il l’impose, se montre lui-même en état d’ébriété tout en draguant un nain noir/gay/juif. Scène aussi hilarante que navrante. La limite de son cinéma se pose là, comme un étendard au milieu d’une morne plaine : que faut-il penser de tout cela ?
Crier à l’imposture, ou à la sincérité névrotique d’un marginal qui filme le prisme réfractaire de son propre reflet. Souvent proche du scandaleux, de la provocation juvénile, du poncif misérabiliste qui vous assène le discours fragile d’une fille en train d’expliquer les attouchements incestueux subis dans sa jeunesse, ou de cette troupe de rednecks imbibés à la bêtise futile avec leur pensée raciste, Gummo surprend dans la diversité des émotions qu’il fait émerger d’une scène à l’autre, soit bouleversant (cette femme qui vit toute la journée avec une poupée), rigolard (ce portrait d’une albinos façon clip MTV), grave (la mère de Solomon qui lui met un arme (fausse) sur la tempe en lui ordonnant de sourire).
D’une misanthropie inconsciente, Gummo se détache de ces congénères, de ces compagnons de galères, de cette Terre abandonnée des Dieux, mais ne fait jamais de ses personnages des singes savants ou des bêtes de foire que l’on viendrait scruter comme dans un cirque. Au contraire, à travers des protagonistes réguliers de son récit atmosphérique, comme Solomon, il crée une empathie ambiguë autour de ses freaks, fait ressortir d’eux une bonté non nocive, une compréhension déserte sur l’innocence déchue, l’apathie d’une âme en perte de repère réel, d’une vie sans forme ponctuée de petits bonheurs rabougris.