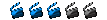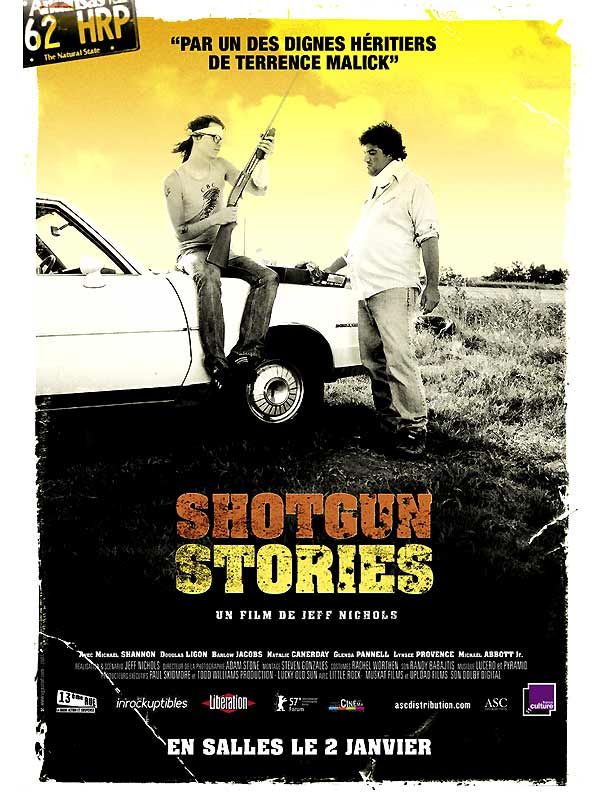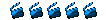Odieux au langage.
Après s’être imposé comme un conteur d’histoire hors pairs, Quentin Tarantino voit grand : il s’agit de se frotter à l’Histoire. Toutes les modifications apportées à son écriture habituelle attestent de cette ambition - qui se révélera un rien pesante par endroits - : de l’Amérique à l’Europe, du contemporain à la Seconde Guerre mondiale, des références bis du tenancier de vidéoclub à l’érudit en matière d’histoire du 7ème art, le cinéaste ne ménage aucun de ses effets.
De la même manière que la transition de maturité fonctionnait entre Pulp Fiction et Jackie Brown, on ne peut que s’incliner face à un grand nombre de réussites. La séquence d’ouverture en est sans doute la preuve la plus éclatante. Vingt minutes d’un dialogue ciselé en trois langues différentes, et au cours duquel tous les enjeux de l’occupation se déroulent entre deux personnages autour d’une table. Des comédiens fantastiques, au premier rang desquels l’incontestable révélation du film, Christoph Waltz, une tension croissante : tout est là, jusqu’à ce plan de la libération filmé depuis l’embrasure de la porte, écho à celui qui clôt La prisonnière du désert.
L’Europe est certes le terrain de l’Histoire, dans laquelle nazis et ennemis vont s’affronter selon les règles du réalisateur : sang, violence, baroque de circonstance sont au rendez-vous, avec certains tics qu’on pourrait juger dispensables (notamment les noms des basterds s’affichant sur l’écran au son de grasses guitares électriques). Mais c’est surtout par le biais du cinéma que Tarantino va s’ouvrir grandes portes du passé. Pabst, Riefenstahl, le cinéma de propagande allemand et ce film en abyme, La Fierté de la nation, vont être l’occasion d’un jouissif exercice de style : le pastiche, certes, mais surtout l’instrument du thème majeur le plus cher au cinéaste, celui de la vengeance. C’est bien entendu une femme, comme dans Kill Bill, qui sera à l’origine ce plan savamment ourdi : exploiter le film comme une arme de destruction massive, à la fois au sens figuré (en introduisant par la magie du montage une contre propagande à l’intérieur du film de propagande) et au sens propre, la bombe à nitrate permettant de purger l’ennemi par le feu. La figure féminine traverse tout le film, en dépit d’un sujet éminemment masculin (l’escouade de barbouzes américains et les nazis qui leur font face) : c’est Shosanna, bien sûr, du rat de cave à la femme fatale qui mourra au ralenti avant de devenir éternelle dans les brumes du brasier, mais aussi Diane Kruger, figure de Cendrillon dont l’identification conduira, à l’inverse du conte, à sa perte.
Sur le plan esthétique, Tarantino limite presque ses effets, si l’on compare sa mise en scène à celle de Kill Bill : certes, on retrouve un certain goût pour le découpage achronique, mais de façon discrète, et la montée et descente du double escalier n’est rien d’autre qu’une citation du célèbre plan-séquence du restaurant. Comme pour la transition entre Kill Bill et le volume 2, c’est sur le terrain de la parole que se déplacent les enjeux. Avec quatre langues différentes, Inglorious Basterds est un festival langagier, au sommet duquel trône une nouvelle fois Christoph Waltz, orfèvre polyglotte. L’écriture s’attache à cette cohabitation forcée des nationalités, et va jusqu’à fouiller l’enjeu des accents au sein de cette comédie des faux semblants. L’autre grande scène du film, écho au prologue, est bien entendu celle de la taverne, interminable échange qui se grippe progressivement, sur le même modèle que la transaction finale dans Django Unchained. La quête de l’accent allemand, la façon dont le SS scrute les rôles de chacun en dit long sur la jubilation d’écriture de Tarantino, qui sait aussi en faire une matière comique, dans l’imparable italien pratiqué par Brad Pitt, américain jusqu’au bout des ongles. Autre élément d’écriture, le plaisir des nicknames, (the jew hunter, the little man, the jew bear…) et les dissertations de chaque personnage sur le sien, sur la légende qui l’accompagne : une tradition depuis Kill Bill et qui ancre encore une fois l’Histoire dans un versant plus pop.
Comme souvent, l’écriture suit les voies de la bifurcation : les plans ne fonctionnent pas comme prévu, et l’improvisation vient toujours épicer la grande machination. C’est sur cette dynamique que Tarantino greffe la grande insolence de sa réécriture de l’Histoire. N’oublions pas que le film commence par le carton « Once upon a time in France »… Puisque tout est possible, puisque nous sommes au cinéma et que les barbares eux-mêmes l’utilisent comme une arme (Hitler à Goebbels : « This is your finest film yet. »), pourquoi se priver ? Le cinéma changera donc le cours du monde.
Rien n’est donc laissé au hasard, et le cinéaste fait feu de tout bois. Si l’entreprise générale est clairement jouissive, l’écriture souvent éclatante, le volontarisme peut accuser certaines limites, dans la reconstitution glamour ou la bouffonnerie, tout comme dans la mise en abyme un peu pesante par moment : Tarantino affirme un peu trop fort, notamment avec la dernière réplique de Brad Pitt : « I think this just might be my masterpiece ! » pour qu’on y adhère pleinement par nous-même. Il n’en demeure pas moins que le sale gosse réussit son pari, et investit le cinéma à l’échelle internationale avec une audace qui n’appartient qu’à lui.