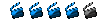[Velvet] Mes bafouilles lunaires 2016
Modérateur: Dunandan
Re: [Velvet] Mes bafouilles lunaires 2016
D'un autre côté, la frontière floue entre stylisation et maniérisme, ça fait très Refn 
-

Mark Chopper - BkRscar
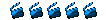
- Messages: 46651
- Inscription: Dim 12 Fév 2012, 13:14
Elle - 7/10
Elle de Paul Verhoeven (2016) - 7/10

Le contrôle et la manipulation sont des thèmes récurrents dans les films de Paul Verhoeven, notamment quand ce dernier s’entoure de personnages féminins comme l’étaient Nomi (Showgirls) ou Catherine Tramell (Basic Instinct). Souvent, ces personnages dominent leurs destins malgré les obstacles, fragilisent les hommes et utilisent sans vergogne leur pouvoir sexuel pour les manipuler. Dans ce nouveau film, Paul Verhoeven examine un sujet controversé avec cette étude de caractère qui s'attache les services d’Isabelle Huppert. Et quel choix. Huppert joue Michèle, propriétaire et chef d'une entreprise de jeux vidéo alors qu’elle débarque du monde de l’édition. Mais c’est lorsqu’elle se fait violer chez elle, que Michèle voit apparaître les premières fissures de son quotidien, un acte qui va renforcer sa carapace et réveiller son instinct de prédatrice car selon « Elle », on n’est jamais aussi bien servi que par soi-même.
Michèle décide donc de traquer son agresseur, qui lui-même continue à la harceler, notamment lorsqu’il rentre chez elle pour jouir sur ses draps. Même si Verhoeven établit une ambiance qui se veut parfois stridente, et qu’il immisce un flou autour de l’identité de l’agresseur, « Elle » ne prend pas le chemin d’un film procès ni le portait victimaire qui crierait haut et fort la violence faite aux femmes. Non, « Elle » est plus tordant et ambigu que cela. « Elle » a cette capacité habile à développer la logique complexe derrière les actions et réponses qui représentent Michèle et son l'individualisme. Dans cette quête hitchcockienne, un jeu du chat et de la souris pervers entre le violeur et Michèle va naître, où chacun va essayer d'obtenir la main sur la domination, et donc de contrôler son « acolyte ».
La première réaction de Michèle suite au viol est surprenante car elle nettoie son appartement et prend un bain, au lieu d'appeler la police et de succomber dans la peau de la victime. Ce serait un signe de faiblesse de la part de cette femme forte et une perte de contrôle cadenassée par le fait qu’elle ne veuille pas que la vindicte populaire s’empare médiatiquement de son agression à cause de son passé et celui de son père meurtrier. D’ailleurs, Verhoeven n’oublie pas de montrer la haine que certains français ressentent pour Michèle, avec cette femme lui jetant son plateau à la figure dans une petite cafétéria.
Paul Verhoeven reviendra à ce viol brutal à plusieurs reprises tout au long du film et plus nous entrons dans l’esprit de Michèle, plus l'image deviendra claire. Mais nous assistons aussi à son fantasme de se vengeance. Alors qu’Elle aurait pu prendre les traits d’un simple « rape and revenge », Verhoeven tord la moelle épinière du film de genre pour en faire un film de mœurs, un concentré de violence frustrée et enfouie au fin fond d’âmes sulfureuses.
Mais dans cette réappropriation du film de genre, Paul Verhoeven s’installe dans l‘univers guindé du film français. Et face aux métastases de ce cinéma, l’auteur hollandais décide d’y injecter un venin dégénératif qui va, avec un second degré et une science du dialogue outrancière qui fonctionnent, démolir les fondations de ce cinéma. Et c’est donc dans cette optique qu’Elle devient le miroir réjouissant d’une satire du septième art français. Pendant que le récit se déroule, Michèle continue à tirer les nombreuses chaînes de sa vie : la gestion de son entreprise avec son ami de longue date tout en ayant une liaison avec le mari de cette même amie, soutenir son fils simplet et inconséquent, s’engueuler avec sa mère harpie ; épier la nouvelle petite amie de son ex-mari et garder un œil un peu coquin sur son voisin.
Ce sont autant de balles à jongler, mais Michèle parvient à le faire avec son esprit sardonique et un certain plaisir, mettant constamment les autres à leur place avec une remarque gauche (« montre-moi ta queue ») ou adroitement cynique. Comme lors de la découverte du nouveau-né de son fils. A travers une mise en scène tirée au cordeau qui se confond avec une luminosité grisâtre, Michèle est un rôle qui exige la plus grande précision de la part de son interprète, et Isabelle Huppert fait éclater son talent pour créer un personnage complexe, sombre et comique, où elle est l’héroïne d'une histoire dans laquelle elle n’est pas exactement rendue sympathique qui la voit mener des actions immorales. Plutôt que de s’empêtrer dans les poncifs de mœurs, Huppert s’avère être un personnage ambigu alimenté par son expérience d'enfantine. Mais le fil rouge du film, ça reste le contrôle de soi et de l’autre. Le contrôle par l’irrationnel et la folie. Michèle veut battre son violeur en se proposant, en se dévisageant. Ses intentions contradictoires font que la relation entre les deux est perturbante, surtout une fois que l’on connait l'identité du violeur qui vient tôt dans le récit.
Et c’est dans ce contraste de tonalité que l’horreur se fait plus grinçante notamment avec une deuxième scène viol proche du consentement et la déviance qui déjoue les codes du film d’horreur (descendre dans une cave) comme dans Les Chiens de Paille de Sam Peckinpah. Michèle refuse de devenir une victime de peur d'être dépouillée de la définition qu’elle s’est faite de soi-même. « Elle » insiste sur la réalisation de son caractère central à travers ses excentricités comme moyen de donner une expérience spécifique à un acte déshumanisant. Dans cette présentation de pulsions sexuelles nauséeuses et proscrites par ce petit monde bourgeois où la religion n’est jamais loin, le personnage d’Isabelle Huppert ressemble à celui qu’elle interprétait déjà dans La pianiste de Michael Haneke. Mais la froideur et la misanthropie de l’autrichien est remplacé par la subversion amusée de l’hollandais. Cependant Verhoeven n’est pas intéressé par la création d’une victime à la norme clairement définie par la conscience collective ni par cette idée obscure que toutes les femmes fantasment sur le viol. Non Verhoeven est plus intelligent que cela et la méticulosité de son film s’hume sur le long terme.
Si le film a un certain mal à se finir et à déterminer la frontière à ne pas dépasser, Elle prend le pouls psychique de Michèle en voulant garder le contrôle : cette sublime idée finale de filiation et de symbiose familiale par la mort. Le film traite d'un sujet grave, mais n'a pas peur de s’appuyer sur son humour noir. « Elle » est un conte de fée fantasmagorique de monstres, symbole d’une hargne d’une jeune fille qui voit graviter le sang autour de son existence. Tout est accentué, en excès, pour s’assurer que le film ne se prenne pas au sérieux et accentuer la gravité du crime : « La honte n’est pas un sentiment assez fort pour nous empêcher de faire quoi que ce soit ».
Michèle décide donc de traquer son agresseur, qui lui-même continue à la harceler, notamment lorsqu’il rentre chez elle pour jouir sur ses draps. Même si Verhoeven établit une ambiance qui se veut parfois stridente, et qu’il immisce un flou autour de l’identité de l’agresseur, « Elle » ne prend pas le chemin d’un film procès ni le portait victimaire qui crierait haut et fort la violence faite aux femmes. Non, « Elle » est plus tordant et ambigu que cela. « Elle » a cette capacité habile à développer la logique complexe derrière les actions et réponses qui représentent Michèle et son l'individualisme. Dans cette quête hitchcockienne, un jeu du chat et de la souris pervers entre le violeur et Michèle va naître, où chacun va essayer d'obtenir la main sur la domination, et donc de contrôler son « acolyte ».
La première réaction de Michèle suite au viol est surprenante car elle nettoie son appartement et prend un bain, au lieu d'appeler la police et de succomber dans la peau de la victime. Ce serait un signe de faiblesse de la part de cette femme forte et une perte de contrôle cadenassée par le fait qu’elle ne veuille pas que la vindicte populaire s’empare médiatiquement de son agression à cause de son passé et celui de son père meurtrier. D’ailleurs, Verhoeven n’oublie pas de montrer la haine que certains français ressentent pour Michèle, avec cette femme lui jetant son plateau à la figure dans une petite cafétéria.
Paul Verhoeven reviendra à ce viol brutal à plusieurs reprises tout au long du film et plus nous entrons dans l’esprit de Michèle, plus l'image deviendra claire. Mais nous assistons aussi à son fantasme de se vengeance. Alors qu’Elle aurait pu prendre les traits d’un simple « rape and revenge », Verhoeven tord la moelle épinière du film de genre pour en faire un film de mœurs, un concentré de violence frustrée et enfouie au fin fond d’âmes sulfureuses.
Mais dans cette réappropriation du film de genre, Paul Verhoeven s’installe dans l‘univers guindé du film français. Et face aux métastases de ce cinéma, l’auteur hollandais décide d’y injecter un venin dégénératif qui va, avec un second degré et une science du dialogue outrancière qui fonctionnent, démolir les fondations de ce cinéma. Et c’est donc dans cette optique qu’Elle devient le miroir réjouissant d’une satire du septième art français. Pendant que le récit se déroule, Michèle continue à tirer les nombreuses chaînes de sa vie : la gestion de son entreprise avec son ami de longue date tout en ayant une liaison avec le mari de cette même amie, soutenir son fils simplet et inconséquent, s’engueuler avec sa mère harpie ; épier la nouvelle petite amie de son ex-mari et garder un œil un peu coquin sur son voisin.
Ce sont autant de balles à jongler, mais Michèle parvient à le faire avec son esprit sardonique et un certain plaisir, mettant constamment les autres à leur place avec une remarque gauche (« montre-moi ta queue ») ou adroitement cynique. Comme lors de la découverte du nouveau-né de son fils. A travers une mise en scène tirée au cordeau qui se confond avec une luminosité grisâtre, Michèle est un rôle qui exige la plus grande précision de la part de son interprète, et Isabelle Huppert fait éclater son talent pour créer un personnage complexe, sombre et comique, où elle est l’héroïne d'une histoire dans laquelle elle n’est pas exactement rendue sympathique qui la voit mener des actions immorales. Plutôt que de s’empêtrer dans les poncifs de mœurs, Huppert s’avère être un personnage ambigu alimenté par son expérience d'enfantine. Mais le fil rouge du film, ça reste le contrôle de soi et de l’autre. Le contrôle par l’irrationnel et la folie. Michèle veut battre son violeur en se proposant, en se dévisageant. Ses intentions contradictoires font que la relation entre les deux est perturbante, surtout une fois que l’on connait l'identité du violeur qui vient tôt dans le récit.
Et c’est dans ce contraste de tonalité que l’horreur se fait plus grinçante notamment avec une deuxième scène viol proche du consentement et la déviance qui déjoue les codes du film d’horreur (descendre dans une cave) comme dans Les Chiens de Paille de Sam Peckinpah. Michèle refuse de devenir une victime de peur d'être dépouillée de la définition qu’elle s’est faite de soi-même. « Elle » insiste sur la réalisation de son caractère central à travers ses excentricités comme moyen de donner une expérience spécifique à un acte déshumanisant. Dans cette présentation de pulsions sexuelles nauséeuses et proscrites par ce petit monde bourgeois où la religion n’est jamais loin, le personnage d’Isabelle Huppert ressemble à celui qu’elle interprétait déjà dans La pianiste de Michael Haneke. Mais la froideur et la misanthropie de l’autrichien est remplacé par la subversion amusée de l’hollandais. Cependant Verhoeven n’est pas intéressé par la création d’une victime à la norme clairement définie par la conscience collective ni par cette idée obscure que toutes les femmes fantasment sur le viol. Non Verhoeven est plus intelligent que cela et la méticulosité de son film s’hume sur le long terme.
Si le film a un certain mal à se finir et à déterminer la frontière à ne pas dépasser, Elle prend le pouls psychique de Michèle en voulant garder le contrôle : cette sublime idée finale de filiation et de symbiose familiale par la mort. Le film traite d'un sujet grave, mais n'a pas peur de s’appuyer sur son humour noir. « Elle » est un conte de fée fantasmagorique de monstres, symbole d’une hargne d’une jeune fille qui voit graviter le sang autour de son existence. Tout est accentué, en excès, pour s’assurer que le film ne se prenne pas au sérieux et accentuer la gravité du crime : « La honte n’est pas un sentiment assez fort pour nous empêcher de faire quoi que ce soit ».
Critiques similaires


-

Velvet - Batman

- Messages: 1710
- Inscription: Dim 16 Juin 2013, 17:34
Killer (The) - 8,5/10
The Killer John Woo (1989) - 8,5/10

Empreint d’une atmosphère pessimiste qui se cristallise aussi bien par son iconographie baroque que par sa facilité d’exécution dans ses scènes d’actions, The Killer accentue les dichotomies de son récit pour en faire un polar souvent étincelant. Polar qui est un film sur des personnages tragiques qui vivent et meurent, en espérant et en luttant pour des idéaux très simples. The Killer met en scène un tueur à gages énigmatique habillé comme les mafieux des années 30 dont le comportement suit le cheminement d’un code d’honneur bien précis : seulement tuer les mauvaises personnes et ne jamais nuire à la bonne. Il veut décrocher, mais sa ligne de conduite patriarcale est mise en danger après qu’il ait accidentellement blessé une chanteuse innocente lors de l’un de ses derniers contrats. Dévasté et épris d’amour pour elle, il décide de réparer son erreur en finalisant d’autres contrats pour payer l’opération chirurgicale qui permettrait à cette femme à ne pas devenir aveugle pendant qu’il aura un flic à ses trousses.
Cette chanteuse deviendra alors le reflet de son salut : sa vie pour la sienne. Un face à face va alors s’intensifier, s’accorder entre fraternité et loyauté et donner, au gré d’une réalisation ébouriffante, naissance à des gunfights mémorables. L’histoire en elle-même est rudimentaire mais terriblement efficace et John Woo laisse beaucoup de mystères sur ses personnages et leurs motivations passées ou présentes, privilégiant de ce fait la symbolique de la situation plutôt que la dramaturgie du dialogue. Dans un monde en perdition, le flic et le tueur à gages vont se retrouver nez à nez face aux mêmes questionnements : la moralité de la justice dans un environnement qui est de plus en plus immoral.
Et pour alimenter cette différenciation entre le bien et le mal, John Woo va instaurer de nombreuses références : notamment religieuses avec l’église catholique comme cadre, point de rencontre qui sert à recevoir les ordres et qui sera le théâtre de combats héroïques. Car dans son histoire, John Woo ne cesse d’iconiser ses personnages, de poétiser ses dialogues, d’en faire des fantasmes de perfection, non pas par la finalité de leurs actes, mais par leur courage, leur abandon de soi pour l’honneur d’une cause qui les dépasse ou dans la volonté de rédemption. Comme s’ils étaient deux anges venus purifier l’enfer d’un monde souterrain qui dérape. John Woo ne prend pas de gant quand il faut mettre le bleu de chauffe et construire ses destins tragiques.
Il immortalise un cinéma total, presque abstrait, qui ne se prive pas de tous les excès, et débouche sur une frontière étroite entre moment extrêmement mielleux façon soap opera et violence à la brutalité qui tombe dans le bain de sang. Le spectacle est grandiloquent, opère sa science par son imagerie féconde dont les ressorts stylistiques outranciers ne font qu’un avec la foi silencieuse des protagonistes. Le réalisateur crie alors tout son amour pour le cinéma et sa vocation purement graphique comme par le biais de nombreux ralentis pendant certaines scènes pour mettre en évidence l'extrémité émotionnelle. D’ailleurs, The Killer n’est pas sans rappeler Le Samouraï de Jean Pierre Melville, non pas dans le style qui s’avère beaucoup plus épuré et mutique chez le français, mais par l’interstice de ce duo vouer à l’échec entre une musicienne et un tueur à gages.
Aussi, The Killer prend les traits de certaines thématiques « Scorsesienne » et sa culpabilité catholique dans un monde d’hommes. Mais derrière ces influences, les balles fusent, le sang gicle, les cadavres se multiplient. John Woo instrumentalise The Killer pour esthétiser au maximum ses obsessions, créer alors l’art de chorégraphier la violence, non pas pour s’en amuser et lui enlever sa force évocatrice, mais pour lui rendre grâce, accorder tout le lyrisme à un acte irrévocable. Par l’élégance de son cadre, la fluidité de son montage, la luminosité, l’urbanisation de son contexte, The Killer en devient un pur régal visuel, un plaisir jouissif mais jamais régressif.
Cette chanteuse deviendra alors le reflet de son salut : sa vie pour la sienne. Un face à face va alors s’intensifier, s’accorder entre fraternité et loyauté et donner, au gré d’une réalisation ébouriffante, naissance à des gunfights mémorables. L’histoire en elle-même est rudimentaire mais terriblement efficace et John Woo laisse beaucoup de mystères sur ses personnages et leurs motivations passées ou présentes, privilégiant de ce fait la symbolique de la situation plutôt que la dramaturgie du dialogue. Dans un monde en perdition, le flic et le tueur à gages vont se retrouver nez à nez face aux mêmes questionnements : la moralité de la justice dans un environnement qui est de plus en plus immoral.
Et pour alimenter cette différenciation entre le bien et le mal, John Woo va instaurer de nombreuses références : notamment religieuses avec l’église catholique comme cadre, point de rencontre qui sert à recevoir les ordres et qui sera le théâtre de combats héroïques. Car dans son histoire, John Woo ne cesse d’iconiser ses personnages, de poétiser ses dialogues, d’en faire des fantasmes de perfection, non pas par la finalité de leurs actes, mais par leur courage, leur abandon de soi pour l’honneur d’une cause qui les dépasse ou dans la volonté de rédemption. Comme s’ils étaient deux anges venus purifier l’enfer d’un monde souterrain qui dérape. John Woo ne prend pas de gant quand il faut mettre le bleu de chauffe et construire ses destins tragiques.
Il immortalise un cinéma total, presque abstrait, qui ne se prive pas de tous les excès, et débouche sur une frontière étroite entre moment extrêmement mielleux façon soap opera et violence à la brutalité qui tombe dans le bain de sang. Le spectacle est grandiloquent, opère sa science par son imagerie féconde dont les ressorts stylistiques outranciers ne font qu’un avec la foi silencieuse des protagonistes. Le réalisateur crie alors tout son amour pour le cinéma et sa vocation purement graphique comme par le biais de nombreux ralentis pendant certaines scènes pour mettre en évidence l'extrémité émotionnelle. D’ailleurs, The Killer n’est pas sans rappeler Le Samouraï de Jean Pierre Melville, non pas dans le style qui s’avère beaucoup plus épuré et mutique chez le français, mais par l’interstice de ce duo vouer à l’échec entre une musicienne et un tueur à gages.
Aussi, The Killer prend les traits de certaines thématiques « Scorsesienne » et sa culpabilité catholique dans un monde d’hommes. Mais derrière ces influences, les balles fusent, le sang gicle, les cadavres se multiplient. John Woo instrumentalise The Killer pour esthétiser au maximum ses obsessions, créer alors l’art de chorégraphier la violence, non pas pour s’en amuser et lui enlever sa force évocatrice, mais pour lui rendre grâce, accorder tout le lyrisme à un acte irrévocable. Par l’élégance de son cadre, la fluidité de son montage, la luminosité, l’urbanisation de son contexte, The Killer en devient un pur régal visuel, un plaisir jouissif mais jamais régressif.
Critiques similaires
| Film: Killer (The) (1989) Note: 8/10 Auteur: Alegas |
Film: Killer (The) (1989) Note: 8/10 Auteur: Mr Jack |
Film: Killer (The) (1989) Note: 10/10 Auteur: Heatmann |
Film: Killer (The) (1989) Note: 10/10 Auteur: Mark Chopper |
Film: Killer (The) (1989) Note: 7/10 Auteur: Waylander |


-

Velvet - Batman

- Messages: 1710
- Inscription: Dim 16 Juin 2013, 17:34
Re: [Velvet] Mes bafouilles lunaires 2016
C'est malin, j'ai envie de le revoir maintenant 

I'm the motherfucker who found this place!
-

Jimmy Two Times - Alien

- Messages: 6545
- Inscription: Ven 16 Juil 2010, 04:37
A nos amours - 9/10
A nos amours de Maurice Pialat (1983) - 9/10

Au bord de l’autoroute, lorsqu’elle quitte Luc dos à dos, on a compris. Instantanément. Suzanne vivote, va d’une relation à une autre mais ne semble pas heureuse. Jeune et tout juste adolescente, elle vit une période où les prémices de l’amour et de la liberté se font sentir. Elle est en plein chamboulement émotionnel. Fait la connaissance des sentiments, des hommes, de la frivolité des relations, du sexe. Cependant, son grand sourire sonne creux, son regard coquin se dévisse et cette vie ne suscite en elle aucune passion. Ni aucun amour, ou seulement une pointe d’affection pour son père. A ses yeux, le temps est une valeur de lassitude où elle ne s’accomplie pas. Il lui permet simplement de passer le temps, pour oublier ou pour échapper à la vérité d’une existence.
Elle se désintéresse de tout, d’une relation déjà oubliée puis trompe Luc avec un inconnu. Elle en pleure, mais pourquoi ? Par remords ou par absence de remords. Elle est désinvolte, n’a aucun problème à faire du mal autour d’elle et utilise les autres, comme on l’utilise. Elle consomme comme elle se consume. Fait partie d’un tout mais aussi et surtout, d’un rien. Ce personnage, aussi fin que complexe, parait détestable à bien des égards, une « petite salope » comme le crie son frère. Mais le destin juge autrement. Avec A nos amours, Maurice Pialat décrie avec férocité la souffrance d’une adolescence amputée par l’atmosphère dysfonctionnelle d’une famille qui se dissout à travers les fantômes des rêves égarés. Et même si l’avalanche de personnages pouvait contraindre le film à esquisser leurs potentiels à la simple surface, Maurice Pialat est un parfait portraitiste et fait de cette ribambelle de « médiocres », un aggloméra déchirant.
Ce n’est de la faute de personne. Maurice Pialat immisce parfois les modulations de son récit dans le spectre de la culpabilité mais la quête existentialiste prédomine. Le réalisateur français ne s’accommode pas d’une histoire rocambolesque ni romanesque mais donne vie aux sentiments, à la violence des relations humaines, un monde où les gifles soufflent de plein fouet. A l’image de son père (Maurice Pialat) qui est aux abonnés absents.
Un ours hirsute et fatigué d’une vie morne et d’un mensonge qu’il ne veut plus dissimuler. Alors, une nuit juste après avoir parlé avec Suzanne, il part. De cette discussion nait alors un sublime instant de cohésion entre un père et une fille : preuve d’une communion, d’une connexion qui dépasse le cadre de l’animosité précédente. Suzanne, au corps divinement érotisé par la caméra mais immature dans son comportement, est incapable d’entreprendre une véritable obsession. Elle ne fait qu’enchainer les histoires sans lendemain. Avec le départ de son père, il n’y a plus rien pour elle dans une maison tapissée par un frère anxiogène et une mère psychiatrique. Sans qu’elle ne sache pourquoi ou comment, elle se rend compte, qu’à l’image d’une fossette, elle a déjà perdu son insouciance, son envie de bouffer la vie.
Tout a disparu, elle n’a plus aucune aspérité. Mais en échange, elle n’a malheureusement rien gagné. Juste de l’amertume, ou la peur de finir comme sa mère : moribonde et des regrets plein la tête. Elle est coincée dans la maison familiale dont l’ambiance se veut insoutenable, notamment par le biais d’un frère qui l’accable de tous les maux du monde. Malgré ses multiples conquêtes d’une nuit, l’amour ne montre toujours pas le bout de son nez. Probablement jamais. Sa recherche d'attention s’étiole. Et dans un style naturaliste qui laisse place à la force des mots et aux montagnes russes d'un montage elliptique, Pialat préfère mettre les sentiments et la situation familiale en avant, plutôt que de raconter une histoire.
A nos amours est un sublime portrait de femmes qui va de ruptures en solitude. Sa beauté, l’affect charnel qui lui permet d’attirer les hommes, va se retourner contre elle et la condamne à attendre la routine du quotidien. Dans sa mise en image, Maurice Pialat n’use jamais d’effet de manche et préfère jalonner son film d’un réalisme qui oscille entre empathie et chagrin. Car même si l’écriture autour du personnage de Suzanne la montre comme quelqu’un qui est parfois insupportable, Maurice Pialat ne prend pas la position de moralisateur mais au contraire, s’assoit dans le siège du sage.
Et c’est alors que dans ce processus fictionnel, Pialat érige une distance entre la caméra et Suzanne, comme pour mieux la contempler. Même si le style que prône A nos amours privilégie la force centrifuge des dialogues, le silence éclate de mille feux, comme durant cette simple scène où Suzanne attend assise sous la pluie à un arrêt de bus. Moment fragile et court, mais qui démontre une véritable puissance visuelle d’un film humble dans sa construction. Mais le plus beau cadeau que nous offre le film, c’est son actrice : Sandrine Bonnaire et la profonde mais durable émotion qu’elle insuffle à son personnage.
Elle se désintéresse de tout, d’une relation déjà oubliée puis trompe Luc avec un inconnu. Elle en pleure, mais pourquoi ? Par remords ou par absence de remords. Elle est désinvolte, n’a aucun problème à faire du mal autour d’elle et utilise les autres, comme on l’utilise. Elle consomme comme elle se consume. Fait partie d’un tout mais aussi et surtout, d’un rien. Ce personnage, aussi fin que complexe, parait détestable à bien des égards, une « petite salope » comme le crie son frère. Mais le destin juge autrement. Avec A nos amours, Maurice Pialat décrie avec férocité la souffrance d’une adolescence amputée par l’atmosphère dysfonctionnelle d’une famille qui se dissout à travers les fantômes des rêves égarés. Et même si l’avalanche de personnages pouvait contraindre le film à esquisser leurs potentiels à la simple surface, Maurice Pialat est un parfait portraitiste et fait de cette ribambelle de « médiocres », un aggloméra déchirant.
Ce n’est de la faute de personne. Maurice Pialat immisce parfois les modulations de son récit dans le spectre de la culpabilité mais la quête existentialiste prédomine. Le réalisateur français ne s’accommode pas d’une histoire rocambolesque ni romanesque mais donne vie aux sentiments, à la violence des relations humaines, un monde où les gifles soufflent de plein fouet. A l’image de son père (Maurice Pialat) qui est aux abonnés absents.
Un ours hirsute et fatigué d’une vie morne et d’un mensonge qu’il ne veut plus dissimuler. Alors, une nuit juste après avoir parlé avec Suzanne, il part. De cette discussion nait alors un sublime instant de cohésion entre un père et une fille : preuve d’une communion, d’une connexion qui dépasse le cadre de l’animosité précédente. Suzanne, au corps divinement érotisé par la caméra mais immature dans son comportement, est incapable d’entreprendre une véritable obsession. Elle ne fait qu’enchainer les histoires sans lendemain. Avec le départ de son père, il n’y a plus rien pour elle dans une maison tapissée par un frère anxiogène et une mère psychiatrique. Sans qu’elle ne sache pourquoi ou comment, elle se rend compte, qu’à l’image d’une fossette, elle a déjà perdu son insouciance, son envie de bouffer la vie.
Tout a disparu, elle n’a plus aucune aspérité. Mais en échange, elle n’a malheureusement rien gagné. Juste de l’amertume, ou la peur de finir comme sa mère : moribonde et des regrets plein la tête. Elle est coincée dans la maison familiale dont l’ambiance se veut insoutenable, notamment par le biais d’un frère qui l’accable de tous les maux du monde. Malgré ses multiples conquêtes d’une nuit, l’amour ne montre toujours pas le bout de son nez. Probablement jamais. Sa recherche d'attention s’étiole. Et dans un style naturaliste qui laisse place à la force des mots et aux montagnes russes d'un montage elliptique, Pialat préfère mettre les sentiments et la situation familiale en avant, plutôt que de raconter une histoire.
A nos amours est un sublime portrait de femmes qui va de ruptures en solitude. Sa beauté, l’affect charnel qui lui permet d’attirer les hommes, va se retourner contre elle et la condamne à attendre la routine du quotidien. Dans sa mise en image, Maurice Pialat n’use jamais d’effet de manche et préfère jalonner son film d’un réalisme qui oscille entre empathie et chagrin. Car même si l’écriture autour du personnage de Suzanne la montre comme quelqu’un qui est parfois insupportable, Maurice Pialat ne prend pas la position de moralisateur mais au contraire, s’assoit dans le siège du sage.
Et c’est alors que dans ce processus fictionnel, Pialat érige une distance entre la caméra et Suzanne, comme pour mieux la contempler. Même si le style que prône A nos amours privilégie la force centrifuge des dialogues, le silence éclate de mille feux, comme durant cette simple scène où Suzanne attend assise sous la pluie à un arrêt de bus. Moment fragile et court, mais qui démontre une véritable puissance visuelle d’un film humble dans sa construction. Mais le plus beau cadeau que nous offre le film, c’est son actrice : Sandrine Bonnaire et la profonde mais durable émotion qu’elle insuffle à son personnage.
Critiques similaires


-

Velvet - Batman

- Messages: 1710
- Inscription: Dim 16 Juin 2013, 17:34
Hardcore Henry - 3/10
Hardcore Henry de Ilya Naishuller (2016) - 3/10

Hardcore Henry s’annonçait comme un projet audacieux. Le jeu vidéo qui rencontre le cinéma. Pourquoi pas. Mais autant le premier arrive de plus en plus à s’imprégner des codes de narration et de caractérisation du cinéma, autant ce dernier a encore beaucoup de mal à donner un second souffle à la vocation vidéoludique du monde des gamers. Hardcore Henry, filmé en mode FPS d’un bout à l’autre à la Doom ou Call of Duty, se plante dans toutes ses largeurs et n’arrive jamais à dépasser le stade des promesses. Et devient même un objet régressif, voire ringard.
Hardcore Henry n’a pas inventé cette idée de vouloir retranscrire la vue à la première personne dans l’univers cinématographique : Maniac de Khalfoun ou à moindre mesure Enther The Void de Noé en sont les exemples les plus flagrants. Alors qu’il se réveille dans un laboratoire cybernétique situé en haute sphère, un homme bionique, sans mémoire et muet, va devoir sauver sa femme des griffes d’un super bad guy. Le pitch est simple sur le papier, mais moins efficace dans son résultat.
L’histoire, qu’on se le dise, n’est qu’un prétexte pour allonger un film qui n’aurait dû rester qu’un simple court métrage jouissif alors qu’en long métrage, il n’est qu’une suite de courses, de combats, de sauts périlleux, de gunfights tremblants et souvent mal fagotés. Comme si le monde des Yamakasi s’était mis à la mode du GoPro. Alors oui Hardcore Henry détient un cadrage lisible, et va droit à l’essentiel dans ses pérégrinations. Dans son parcours, il prend les traits d’un jeu de plateforme qui avance niveau par niveau, allant de décors en décors passant du club de strip tease à l’immeuble délabré. Plus le film avance, plus les hommes à combattre sont nombreux et puissants.
A chaque combat, à chaque boss effacé, le personnage d’Henry obtient des indications sur la suite des événements pour aller d’un point A jusqu’à un point B. C’est simple et ça n’a pas forcément l’ambition d’en vouloir autrement. Pour parachever sa quête, Henry sera accompagné d’une sorte de mercenaire qui à chaque fois qu’il meurt, réapparaitra pour de nouveau tenir compagnie à notre héros. Une sorte de running gag potache qui prend le parti pris du monde des vies. Dans le film, comme dans les jeux, plusieurs tentatives sont permises. Même si cette faculté de réincarnation est un élément du scénario qui sera révélé plus tard dans le film.
Malgré toutes ses bonnes intentions, son côté inventif dans ses prises de vue, ses compositions graphiques, ses moments de bravoure qui fonctionnent comme lors decette course poursuite en side car, Hardcore Henry ne s’émeut jamais de son aspect ultra répétitif. En termes de violence, les corps s’empilent les uns sur les autres de façon plus ou moins gore comme lors ce final qui voit une tête coupée dans sa moitié. Certes le spectacle peut paraitre novateur et ne se prive d’aucune barrière dans la graduation de ses étapes, mais atteint ses propres limites. Mais ce qui frappe le plus, malgré cette vue à la première personne et cette violence qui lâche ses coups, Hardcore Henry est peu immersif, peu enclin à faire ressentir les blessures physiques de son hôte. L’objet visuel amusant devient malheureusement lassant.
Là où des films comme les très « beat them all » The Raid ou The Raid 2 arrivent à insérer de vraies idées cinématographiques avec un sens du montage incroyable et témoignent d’une vraie puissance dans leur chorégraphie scénique, Hardcore Henry parait moins limpide dans sa tenue visuelle et s’agence avec moins de fluidité. La vision du protagoniste parait souvent en inadéquation avec les mouvements de son corps. D’ailleurs, le protagoniste et l’empathie autour de lui sont les points noirs du film, surtout quand les violons sont de sortie. Quand le spectacle se fait moins intéressant dans sa frénésie, Hardcore henry est incapable d’émouvoir ni d’asseoir un grain de récit.
Parlant de la robotisation du monde et d’une nouvelle ère d’être humain, Hardcore Henry ne témoigne jamais d’un propos sur l’identité et la dimension de l’être humain dans son mélange mécanique. Sans vouloir attendre une intelligence thématique à la David Cronenberg sur la déviance entre l’homme et la matérialité, Hardcore Henry rate son pari dans son défouloir trop agressif d’anticipation pour fasciner et manque une chance de créer une véritable mythologie. Le final, le combat contre le boss final est le symbole d’un film over the top, qui ne sait pas différencier la générosité à l’écœurement. Trop de combat tue le combat où l’on voit Henry se battre contre une armée conséquente dans une baston parfois illisible et interminable.
Hardcore Henry n’a pas inventé cette idée de vouloir retranscrire la vue à la première personne dans l’univers cinématographique : Maniac de Khalfoun ou à moindre mesure Enther The Void de Noé en sont les exemples les plus flagrants. Alors qu’il se réveille dans un laboratoire cybernétique situé en haute sphère, un homme bionique, sans mémoire et muet, va devoir sauver sa femme des griffes d’un super bad guy. Le pitch est simple sur le papier, mais moins efficace dans son résultat.
L’histoire, qu’on se le dise, n’est qu’un prétexte pour allonger un film qui n’aurait dû rester qu’un simple court métrage jouissif alors qu’en long métrage, il n’est qu’une suite de courses, de combats, de sauts périlleux, de gunfights tremblants et souvent mal fagotés. Comme si le monde des Yamakasi s’était mis à la mode du GoPro. Alors oui Hardcore Henry détient un cadrage lisible, et va droit à l’essentiel dans ses pérégrinations. Dans son parcours, il prend les traits d’un jeu de plateforme qui avance niveau par niveau, allant de décors en décors passant du club de strip tease à l’immeuble délabré. Plus le film avance, plus les hommes à combattre sont nombreux et puissants.
A chaque combat, à chaque boss effacé, le personnage d’Henry obtient des indications sur la suite des événements pour aller d’un point A jusqu’à un point B. C’est simple et ça n’a pas forcément l’ambition d’en vouloir autrement. Pour parachever sa quête, Henry sera accompagné d’une sorte de mercenaire qui à chaque fois qu’il meurt, réapparaitra pour de nouveau tenir compagnie à notre héros. Une sorte de running gag potache qui prend le parti pris du monde des vies. Dans le film, comme dans les jeux, plusieurs tentatives sont permises. Même si cette faculté de réincarnation est un élément du scénario qui sera révélé plus tard dans le film.
Malgré toutes ses bonnes intentions, son côté inventif dans ses prises de vue, ses compositions graphiques, ses moments de bravoure qui fonctionnent comme lors decette course poursuite en side car, Hardcore Henry ne s’émeut jamais de son aspect ultra répétitif. En termes de violence, les corps s’empilent les uns sur les autres de façon plus ou moins gore comme lors ce final qui voit une tête coupée dans sa moitié. Certes le spectacle peut paraitre novateur et ne se prive d’aucune barrière dans la graduation de ses étapes, mais atteint ses propres limites. Mais ce qui frappe le plus, malgré cette vue à la première personne et cette violence qui lâche ses coups, Hardcore Henry est peu immersif, peu enclin à faire ressentir les blessures physiques de son hôte. L’objet visuel amusant devient malheureusement lassant.
Là où des films comme les très « beat them all » The Raid ou The Raid 2 arrivent à insérer de vraies idées cinématographiques avec un sens du montage incroyable et témoignent d’une vraie puissance dans leur chorégraphie scénique, Hardcore Henry parait moins limpide dans sa tenue visuelle et s’agence avec moins de fluidité. La vision du protagoniste parait souvent en inadéquation avec les mouvements de son corps. D’ailleurs, le protagoniste et l’empathie autour de lui sont les points noirs du film, surtout quand les violons sont de sortie. Quand le spectacle se fait moins intéressant dans sa frénésie, Hardcore henry est incapable d’émouvoir ni d’asseoir un grain de récit.
Parlant de la robotisation du monde et d’une nouvelle ère d’être humain, Hardcore Henry ne témoigne jamais d’un propos sur l’identité et la dimension de l’être humain dans son mélange mécanique. Sans vouloir attendre une intelligence thématique à la David Cronenberg sur la déviance entre l’homme et la matérialité, Hardcore Henry rate son pari dans son défouloir trop agressif d’anticipation pour fasciner et manque une chance de créer une véritable mythologie. Le final, le combat contre le boss final est le symbole d’un film over the top, qui ne sait pas différencier la générosité à l’écœurement. Trop de combat tue le combat où l’on voit Henry se battre contre une armée conséquente dans une baston parfois illisible et interminable.
Critiques similaires
| Film: Hardcore Henry Note: 3/10 Auteur: Nulladies |
Film: Hardcore Henry Note: 2/10 Auteur: Alegas |
Film: Hardcore Henry Note: 0/10 Auteur: Scalp |


-

Velvet - Batman

- Messages: 1710
- Inscription: Dim 16 Juin 2013, 17:34
Witch (The) - 7,5/10
The Witch de Robert Eggers (2016) - 7,5/10

The Witch est déconcertant. En 1630, une famille bannie de son village va vivre à l’écart de la société et prospérer proche de la forêt. Pour se sentir en osmose totale avec les cieux et loin de la corruption d’un monde impie. Tout va basculer lorsque l’un de leurs enfants va disparaître. La première bonne idée de The Witch est de ne jamais cacher ses intentions : celle ne pas faire un film d’horreur stricto sensu. Il ne faut pas se leurrer : ceux qui s’attendent à frissonner de frayeurs seront déçus. Un peu comme ceux qui voulaient à tout prix du fantastique dans Le Village de Night Shyamalan. Dès les premiers instants, le réalisateur met un visage sur le mal qui sévit dans cette forêt dans une scène parfaite de rituel et plante le décor de ce monde qui cohabite entre surnaturel et reconstitution d’époque. Toute ambiguïté sur la nature de ce mal est dissipée. C’est alors qu’Eggers fait du spectateur un témoin privilégié du sort de l’enfant enlevé.
A cet effet, Il change de camp le socle de la peur. Au lieu de se définir comme un film qui veut faire peur, The Witch est une œuvre sur la peur. Dans un premier temps, Eggers favorise la représentation physique de celle-ci mais c’est celle de l’esprit qui va se sanctuariser et nécroser toute cette famille. Celle qui gangrène la solidarité d’une famille, celle qui provient de la nature humaine et de l’intérieur des viscères. La famille est dans le flou après la disparition du bébé. Le spectateur connait la menace, alors que la famille non. Et dans cette expectative, la famille, très pieuse invoquant ad vitam aeternam la grâce de dieu et la peur de l’enfer, va perdre pied et succomber à la folie.
Tout en y insérant une dose de sorcellerie, The Witch devient rapidement un huit clos suffocant, une étude de caractère passionnante d’une communauté dévorée par la religion et l’isolement social où la suspicion va naître autour de chaque membre de la famille. Et notamment autour de l’adolescente Thomasin, épicentre et réceptacle de toutes les intentions et de toutes les envies : la peur et haine des jumeaux, tentation charnelle pour son jeune frère et jalousie de la part de sa mère. Epris d’un pragmatisme cinématographique abouti, The Witch ne s’insère pas dans la lignée des The Conjuring ou Insidious. Ne tombant jamais dans le piège d’effet ostentatoire dans sa réappropriation de l’horreur (absence de jump scare), le film se repose notamment sur sa fulgurance scénique et la cartographie terrifiante de son environnement.
The Witch joue sur l’économie tant dans sa rythmique monolithique que dans sa courte durée, démontrant autant les qualités par l’immersion de son réalisme que les limites de ce premier long métrage quant à sa puissance évocatrice. Que cela soit sa photographie grisâtre et picturale incroyable, sa direction d’acteur habitée, sa bande sonore qui fluctue sa tension avec minutie et sa mise en scène, certes austère, mais jamais autiste dans l’approche de son rythme, The Witch offre là un véritable tour de force. La terreur s’émancipe par le simple fait de son atmosphère, de son clivage entre la chaleur du feu et la froideur des visages qui se liquéfient avec le temps ou la fragmentation entre ce langage biblique archaïque et la sophistication de sa réalisation.
Robert Eggers entrevoit l’horreur par le prisme de la vétusté de ces lieux et la claustrophobie ambiante de ce fanatisme. Ce qui permet au film d’engendrer de véritables beaux moments de cinéma comme en témoigne cette séquence où Caleb découvre le mal qui rode dans les bois ou les hallucinations d’une mère aux abois. Conte satanique aux pistes de lectures riches sur l’affranchissement et « l’élévation » de la femme et l’éveil des sens à l’adolescence, The Witch est un tableau magnifique aussi portraitiste qu’expressionniste. Comme si Le Village et Antichrist de Lars Von Trier ne faisait qu’un.
A cet effet, Il change de camp le socle de la peur. Au lieu de se définir comme un film qui veut faire peur, The Witch est une œuvre sur la peur. Dans un premier temps, Eggers favorise la représentation physique de celle-ci mais c’est celle de l’esprit qui va se sanctuariser et nécroser toute cette famille. Celle qui gangrène la solidarité d’une famille, celle qui provient de la nature humaine et de l’intérieur des viscères. La famille est dans le flou après la disparition du bébé. Le spectateur connait la menace, alors que la famille non. Et dans cette expectative, la famille, très pieuse invoquant ad vitam aeternam la grâce de dieu et la peur de l’enfer, va perdre pied et succomber à la folie.
Tout en y insérant une dose de sorcellerie, The Witch devient rapidement un huit clos suffocant, une étude de caractère passionnante d’une communauté dévorée par la religion et l’isolement social où la suspicion va naître autour de chaque membre de la famille. Et notamment autour de l’adolescente Thomasin, épicentre et réceptacle de toutes les intentions et de toutes les envies : la peur et haine des jumeaux, tentation charnelle pour son jeune frère et jalousie de la part de sa mère. Epris d’un pragmatisme cinématographique abouti, The Witch ne s’insère pas dans la lignée des The Conjuring ou Insidious. Ne tombant jamais dans le piège d’effet ostentatoire dans sa réappropriation de l’horreur (absence de jump scare), le film se repose notamment sur sa fulgurance scénique et la cartographie terrifiante de son environnement.
The Witch joue sur l’économie tant dans sa rythmique monolithique que dans sa courte durée, démontrant autant les qualités par l’immersion de son réalisme que les limites de ce premier long métrage quant à sa puissance évocatrice. Que cela soit sa photographie grisâtre et picturale incroyable, sa direction d’acteur habitée, sa bande sonore qui fluctue sa tension avec minutie et sa mise en scène, certes austère, mais jamais autiste dans l’approche de son rythme, The Witch offre là un véritable tour de force. La terreur s’émancipe par le simple fait de son atmosphère, de son clivage entre la chaleur du feu et la froideur des visages qui se liquéfient avec le temps ou la fragmentation entre ce langage biblique archaïque et la sophistication de sa réalisation.
Robert Eggers entrevoit l’horreur par le prisme de la vétusté de ces lieux et la claustrophobie ambiante de ce fanatisme. Ce qui permet au film d’engendrer de véritables beaux moments de cinéma comme en témoigne cette séquence où Caleb découvre le mal qui rode dans les bois ou les hallucinations d’une mère aux abois. Conte satanique aux pistes de lectures riches sur l’affranchissement et « l’élévation » de la femme et l’éveil des sens à l’adolescence, The Witch est un tableau magnifique aussi portraitiste qu’expressionniste. Comme si Le Village et Antichrist de Lars Von Trier ne faisait qu’un.
Critiques similaires


-

Velvet - Batman

- Messages: 1710
- Inscription: Dim 16 Juin 2013, 17:34
Re: [Velvet] Mes bafouilles lunaires 2016
Velvet a écrit:Comme si Le Village et Antichrist de Lars Von Trier ne faisait qu’un.
Ça m'effraie autant que ça m'attire.
-

Alegas - Modo Gestapo
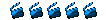
- Messages: 52455
- Inscription: Mar 11 Mai 2010, 14:05
- Localisation: In the Matrix
Re: [Velvet] Mes bafouilles lunaires 2016
Idem, c'est bien pourri Le village.
-

osorojo - Superman
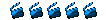
- Messages: 23016
- Inscription: Dim 15 Aoû 2010, 22:51
-

Alegas - Modo Gestapo
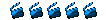
- Messages: 52455
- Inscription: Mar 11 Mai 2010, 14:05
- Localisation: In the Matrix
Strangers (2016) (The) - 8/10
The Strangers de Na Hong-Jin (2016) - 8/10

Fort de deux premiers films extrêmement prometteurs que sont The Chaser et The Murderer, Na Hong-Jin revient aux affaires avec une nouvelle création qui explore profondément les racines exubérantes d’une certaine forme du cinéma sud-coréen. Tous les ingrédients connus sont bel et bien présents : personnages qui virevoltent entre drame sauvage et comédie potache, anti héros patibulaire et médiocre, violence sanguinolente qui tache les murs, paysage naturaliste envoûtant, enquête policière qui rame à cause de l’incompétence notoire des agents de police. The Strangers parait être un énième film sud-coréen voulant marcher sur les plats de bande du culte Memories of Murder dans les contrées isolées d’une Corée du Sud coupée du monde.
D’ailleurs les premières minutes du long métrage vont dans ce sens-là avec des ruptures de tons allant de la comédie familiale (scènes familiales burlesques comme la fille qui surprend ses parents qui baisent dans la voiture) au thriller organique pluvieux et ses meurtres macabres et mystiques, où les influences de Seven et True Detective semblent imposantes. Mais malgré ce décorum qui semble épouser les codes du genre, The Strangers a d’autres cordes à son arc. Le naturalisme semble prédominer, mais les carcans de ce cinéma-là vont être bouleversés par l’intégration du fantastique.
Et c’est ce qui va faire tout le sel d’une œuvre coup de poing à la richesse aussi foisonnante que confuse dans sa mise en place. Les meurtres se suivent et la folie contagieuse qui vocifère dans ce petit village commence à devenir insoutenable sachant que les causes des morts sont aussi similaires qu’inexplicables. Mais dans ces petites bourgades où tout le monde se connait et où tout le monde épie les moindres faits et gestes de chacun, la rumeur va bon train. Celle de quelque chose qui dépasse le cadre de la simple science et qui met de côté la plausible prise de champignons anxiogènes qui rendrait fous. La réponse se voudrait spectrale, supérieure à l’humain.
La sanction d’un fantôme. Alors que l’enquête policière se trouve dans un cul de sac avec une jeune femme qui se volatilise après avoir donnée de réels indices ou le foudroiement surprenant d’un témoin, le film va prendre une autre tournure quand la fille du sergent en charge de l’affaire se mettra à avoir un comportement bizarre, similaire à celui des précédents meurtres. Et à partir de ce moment-là, le film déploie sa mécanique et sa maitrise qui marche sur un fil, avec un changement de rythme en corrélation avec l’accélération des enjeux. Na Hong-Jin trouve alors un point d’encrage émotionnel à son récit et fait basculer son film dans une course contre la montre d’un père voulant sauver sa fille d’une emprise qui n’est pas humaine. Virant dans le genre de la possession et du film d’exorcisme, The Strangers met un peu de côté sa quête policière. Ce n’est plus l’affaire de la justice face à sa criminalité.
C’est le combat de l’homme face à ce qu’il ne comprend pas, sa peur de l’inconnu : de la divinité, de la mort qui se réincarne dans sa forme la plus organique. Et cette volonté que l’épicentre de la thématique se fasse autour d’un Japonais vagabond donne à ce mysticisme une tonalité sociale qui questionne sur l’aspect communautaire de la société que veut décrire l’auteur. Alors que l’œuvre aurait pu sombrer dans la facétie la plus totale, dans la farce de série Z abrutissante, The Strangers garde le cap et continue à tracer son chemin avec son sérieux iconique incroyable (sublime et spectrale Chun Woo-hee) et humour décalé comme le témoigne cette bagarre contre un zombie quasiment indestructible.
Mais ce qui rend le film terriblement compact, c’est la sincérité de l’entreprise. Na Hong-Jin ne fait jamais de The Strangers un film de petit malin qui voudrait brouiller les pistes pour imaginer des rebondissements qui useraient la patience du spectateur. La croyance, l’impuissance de la religion face à l’inexplicable, la fatalité de la mort et de sa présence au bout milieu de la vie, la catégorisation des humains élargissent le champ d’application d’un récit foutraque. On sent une vraie volonté de s’affranchir et d’adouber le film de genre.
Et pour se faire, le réalisateur utilise ses qualités de cinéastes pour agencer cette terreur qui ne fait que s’agrandir au fur et à mesures du métrage. Alors que le climax horrifique se voudrait effrayant, The Strangers prend des chemins de traverses différents (à l’instar de The Witch) et force le respect par la mise en image de ses incantations (somptueux montage de la séquence du sort tout en puissance) et l’incarnation parfaite du malin dans sa finalité, tout en oubliant jamais l’émotion. C’est toute la grandeur de The Strangers : malgré cette volonté d’élever le récit dans des sphères divines, Na Hong-Jin n’a jamais aussi bien filmé les peurs et les émotions de l’humanité.
D’ailleurs les premières minutes du long métrage vont dans ce sens-là avec des ruptures de tons allant de la comédie familiale (scènes familiales burlesques comme la fille qui surprend ses parents qui baisent dans la voiture) au thriller organique pluvieux et ses meurtres macabres et mystiques, où les influences de Seven et True Detective semblent imposantes. Mais malgré ce décorum qui semble épouser les codes du genre, The Strangers a d’autres cordes à son arc. Le naturalisme semble prédominer, mais les carcans de ce cinéma-là vont être bouleversés par l’intégration du fantastique.
Et c’est ce qui va faire tout le sel d’une œuvre coup de poing à la richesse aussi foisonnante que confuse dans sa mise en place. Les meurtres se suivent et la folie contagieuse qui vocifère dans ce petit village commence à devenir insoutenable sachant que les causes des morts sont aussi similaires qu’inexplicables. Mais dans ces petites bourgades où tout le monde se connait et où tout le monde épie les moindres faits et gestes de chacun, la rumeur va bon train. Celle de quelque chose qui dépasse le cadre de la simple science et qui met de côté la plausible prise de champignons anxiogènes qui rendrait fous. La réponse se voudrait spectrale, supérieure à l’humain.
La sanction d’un fantôme. Alors que l’enquête policière se trouve dans un cul de sac avec une jeune femme qui se volatilise après avoir donnée de réels indices ou le foudroiement surprenant d’un témoin, le film va prendre une autre tournure quand la fille du sergent en charge de l’affaire se mettra à avoir un comportement bizarre, similaire à celui des précédents meurtres. Et à partir de ce moment-là, le film déploie sa mécanique et sa maitrise qui marche sur un fil, avec un changement de rythme en corrélation avec l’accélération des enjeux. Na Hong-Jin trouve alors un point d’encrage émotionnel à son récit et fait basculer son film dans une course contre la montre d’un père voulant sauver sa fille d’une emprise qui n’est pas humaine. Virant dans le genre de la possession et du film d’exorcisme, The Strangers met un peu de côté sa quête policière. Ce n’est plus l’affaire de la justice face à sa criminalité.
C’est le combat de l’homme face à ce qu’il ne comprend pas, sa peur de l’inconnu : de la divinité, de la mort qui se réincarne dans sa forme la plus organique. Et cette volonté que l’épicentre de la thématique se fasse autour d’un Japonais vagabond donne à ce mysticisme une tonalité sociale qui questionne sur l’aspect communautaire de la société que veut décrire l’auteur. Alors que l’œuvre aurait pu sombrer dans la facétie la plus totale, dans la farce de série Z abrutissante, The Strangers garde le cap et continue à tracer son chemin avec son sérieux iconique incroyable (sublime et spectrale Chun Woo-hee) et humour décalé comme le témoigne cette bagarre contre un zombie quasiment indestructible.
Mais ce qui rend le film terriblement compact, c’est la sincérité de l’entreprise. Na Hong-Jin ne fait jamais de The Strangers un film de petit malin qui voudrait brouiller les pistes pour imaginer des rebondissements qui useraient la patience du spectateur. La croyance, l’impuissance de la religion face à l’inexplicable, la fatalité de la mort et de sa présence au bout milieu de la vie, la catégorisation des humains élargissent le champ d’application d’un récit foutraque. On sent une vraie volonté de s’affranchir et d’adouber le film de genre.
Et pour se faire, le réalisateur utilise ses qualités de cinéastes pour agencer cette terreur qui ne fait que s’agrandir au fur et à mesures du métrage. Alors que le climax horrifique se voudrait effrayant, The Strangers prend des chemins de traverses différents (à l’instar de The Witch) et force le respect par la mise en image de ses incantations (somptueux montage de la séquence du sort tout en puissance) et l’incarnation parfaite du malin dans sa finalité, tout en oubliant jamais l’émotion. C’est toute la grandeur de The Strangers : malgré cette volonté d’élever le récit dans des sphères divines, Na Hong-Jin n’a jamais aussi bien filmé les peurs et les émotions de l’humanité.
Critiques similaires
| Film: Strangers (The) (2016) Note: 8/10 Auteur: Alegas |
Film: Strangers (The) (2016) Note: 5/10 Auteur: Dunandan |
Film: Strangers (The) (2016) Note: 7/10 Auteur: Nulladies |


-

Velvet - Batman

- Messages: 1710
- Inscription: Dim 16 Juin 2013, 17:34
Re: [Velvet] Mes bafouilles lunaires 2016
Je le découvre demain, comment j'ai hâte bordel. 





-

Alegas - Modo Gestapo
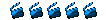
- Messages: 52455
- Inscription: Mar 11 Mai 2010, 14:05
- Localisation: In the Matrix
Dark Knight, Le Chevalier Noir (The) - 9/10
The Dark Knight de Christopher Nolan (2008) - 9/10

[justify]Batman Begins posait la première pierre à l’édifice voué au culte du super héros masqué. Dans un processus initiatique troublé par la perte de ses parents jadis et sa volonté de venger la mémoire et l’honneur d’une ville qui sombre dans la criminalité, Bruce Wayne n’avait qu’un seul mot en tête : la justice. Et dans une continuité parfaitement cohérente, The Dark Knight mettra cette notion à toute épreuve : quel visage doit avoir la justice ? Jusqu’où peut-elle aller pour diriger ? La première chose que l’on remarque, c’est l’aspect plus réaliste de l’environnement. Gotham n’est plus cette ville malfamée et poisseuse qui dessinait ses traits presque fantomatiques dans Batman Begins. Dans ce deuxième opus, la métropole prend des allures de ville ancrée dans le réel : celle de Chicago. Comme si Nolan voulait désacraliser l’affect fantasmatique du film de super héros pour rendre les enjeux encore plus parlants et évocateurs dans leurs répercussions.
Une importance de l’imagerie du réel qui est habituelle dans sa filmographie. Surtout que Batman aura fort à faire dans cette deuxième partie de la trilogie puisqu’il sera face à son plus fidèle ennemi : le Joker. Malgré le costume de la chauve-souris et du maquillage, tout est crédible dans son cheminement. Le combat mettra alors en exergue des thématiques au modernisme troublant. Car derrière son costume de film de blockbuster spectaculaire qui ne tombera jamais dans la paresse du climax pyrotechnique, The Dark Knight est un polar redoutable sous la dialyse du film choral qui se verra affecté par des questionnements politiques passionnants.
Chaque personnage - Batman, Harvey Dent, Gordon – ont leur propre vision de la justice pour contrer le mal qu’incarne le Joker (incroyable Heath Ledger). Ce qui est fort chez Nolan, c’est de faire vivre ses personnages par leur interaction profonde avec leur environnement et leurs volontés qui en découlent. Dans le bas monde que crée Christopher Nolan, le bien et de mal se confondent. Ces deux clés de la démocratie vivent en parfaite communion tant que l’un des deux ne domine pas l’autre. La police est corrompue par peur ou profit et la pègre dirige tout en gardant un code d’honneur pour se noyer dans une moralité hypocrite. Mais tout cela se contrôle de lui-même dans un film qui s’interrogera sur la primauté de l’Ordre et de l’intérêt général dans la démocratie. Et c’est là que le Joker prend tout son sens : sa place, sa fantaisie, sa folie, sa destruction, son nihilisme presque amusant et amusé. Il est le chaos à lui tout seul. Une force centrifuge qui ne demande qu’à voir le mal s’incarner par lui-même ou par l’utilisation de stratagème, comme en témoignent la séquence des bateaux ou ce chantage entre la mort d’un homme contre l’explosion d’un hôpital.
Il est le fantôme qui circule en chacun de nous : on peut tous passer de l’autre côté. Il est un effet placebo mais déplacé vers sa version morbide. Et cette fameuse séquence de bateau est un saut de foi un peu naïf mais est symptomatique de la volonté du personnage : le reflet de l’humanité et le droit de vie ou de mort sur les autres. The Dark Knight voit la bonté de l'Homme, faisant face à la vengeance et son instinct de survie qui peut le pervertir. Dans une première séquence de braquage de banque que ne renierait pas Mickael Mann, le film se décrit de lui-même : un par un les braqueurs se tuent entre eux dans l’optique de l’appas du gain mais le seul qui survit c’est le chef, masqué et fourbe qu’est le Joker. Il laisse les autres entre-tuer dans le mensonge et l’aveuglement du pouvoir où « la folie suit les lois de la gravité ». Il est incontrôlable et invisible, le visage d’une anarchie qui aime se fier aux hasards. Mais avant tout chose, avant d’être un film à thèse riche mais pas toujours très subtil dans son exécution, The Dark Knight n’en reste pas moins un film d’une qualité cinématographique parfaite, dans le rythme de ses rebondissements et l’excellence de sa mise en image : géniale séquence de course poursuite.
Critiques similaires
| Film: Dark Knight : Le Chevalier noir (The) Note: 7,5/10 Auteur: pabelbaba |
Film: Dark Knight : Le Chevalier noir (The) Note: 9/10 Auteur: B00lz |
Film: Dark Knight : Le Chevalier noir (The) Note: 9/10 Auteur: corrosion |
Film: Dark Knight : Le Chevalier noir (The) Note: 8,5/10 Auteur: helldude |
Film: Dark Knight : Le Chevalier noir (The) Note: 7,5/10 Auteur: osorojo |


-

Velvet - Batman

- Messages: 1710
- Inscription: Dim 16 Juin 2013, 17:34
Enfance d'Ivan (L') - 7,5/10
L'Enfance d'Ivan de Andrei Tarkovski (1963) - 7,5/10

Il n’a que les os sur la peau. Du haut de sa petite tête blonde, Ivan n’a quasiment plus rien à apprendre des méandres de la vie. Dès sa première incursion en tant qu’éclaireur, il semble se maitriser et sait ce qu’il doit faire. Il est franc, autoritaire et malgré sa taille d’enfant, donne des ordres comme un vieux de la vieille. Certes, son regard est encore vif, jeune et son rare sourire crie à la naïveté mais Ivan a déjà perdu son enfance. L’enfance d’Ivan : le titre est presque illusoire tant Ivan marche sur les rotules dans sa quête. Et cette écriture, qui enlève toute trace de voilure puérile autour de son personnage, est le premier tour de force émotionnel du réalisateur : celle de dessiner un enfant qui n’en est plus réellement un, un singe savant, un monstre qui n’a pas encore exorcisé ses plaies.
Une enfance, il n’en a pas ou pas eu. Entouré d’adultes, aussi lâches que courageux, il ne dépareille pas dans cet univers apocalyptique qu’Andrei Tarkovski prend le temps d'accroître sa dimension. Son quotidien est la guerre, le destin de ces hommes morts au front et de ses femmes perdant la vie par lâcheté de l’ignominie humaine. Par ses camarades ou ses supérieurs hiérarchiques, il est considéré comme un gosse mais ce n’est qu’un mirage. Ils se servent de lui comme de la pure chair à canon. Sans que personne ne prête attention aux divagations d’Ivan : il se murmure la folie, comme une tempête sous un crâne.
Dans la mémoire d’Ivan : les visages de sa sœur et de sa mère installent leur contour, et sous le choc du chaos, prennent la forme de deux anges qui s’échappent de l’obscurité. Ces réminiscences, ces souvenirs sont aussi bienfaiteurs que délétères pour son ôte : l’illusion d’un passé joyeux qui s’efface dans la réalité d’un présent sans futur. Dans ce conflit armé jusqu’aux dents, Andrei Tarkovski fait un film de guerre : d’une part la démonstration explicite du conflit, sa tension et sa froideur mais aussi et surtout, tout ce qui entoure le déploiement du combat. Et c’est là que le subjectif fait face à l’objectif, que les songes rencontrent la réalité. Non l’auteur ne jouit jamais d’une apparence spectaculaire dans son accoutrement. Ses effets, la mise en scène : tout est d’une grande humilité et d’une parfaite fluidité. La photographie est somptueuse, et dès son premier coup d’essai, Andrei Tarkovski démontre qu’il est un incroyable portraitiste, un peintre qui magnifie le contour des visages pour forger avec vigueur toute la teneur des expressions.
Mais qui dit temps de guerre, dit environnement hostile. Et afin de parfaire sa construction, Andrei Tarkovski dévoile sa plus grande qualité : celle d’esthète, d’un maitre qui n’a pas son pareil pour hypnotiser son auditoire par la désolation de ses paysages, le désœuvrement de ses plaines sèches de tout espoir. Prenant alors les allures d’un conte morbide, L’enfance d’Ivan garde une droiture, une rugosité dans l’émotion qui oblige le film, de lui-même, à garder une certaine distance avec son sujet. D’où la frontière assez paradoxale entre émerveillement et distance indifférente. Mais c’est sans compter sur la fin du film, qui offre une magie de mise en scène entre cette dichotomie entre les images qui suinte la mort des captifs sans la montrer et les voix de tortionnaires. Mais pouvait-il en être autrement ?
Une enfance, il n’en a pas ou pas eu. Entouré d’adultes, aussi lâches que courageux, il ne dépareille pas dans cet univers apocalyptique qu’Andrei Tarkovski prend le temps d'accroître sa dimension. Son quotidien est la guerre, le destin de ces hommes morts au front et de ses femmes perdant la vie par lâcheté de l’ignominie humaine. Par ses camarades ou ses supérieurs hiérarchiques, il est considéré comme un gosse mais ce n’est qu’un mirage. Ils se servent de lui comme de la pure chair à canon. Sans que personne ne prête attention aux divagations d’Ivan : il se murmure la folie, comme une tempête sous un crâne.
Dans la mémoire d’Ivan : les visages de sa sœur et de sa mère installent leur contour, et sous le choc du chaos, prennent la forme de deux anges qui s’échappent de l’obscurité. Ces réminiscences, ces souvenirs sont aussi bienfaiteurs que délétères pour son ôte : l’illusion d’un passé joyeux qui s’efface dans la réalité d’un présent sans futur. Dans ce conflit armé jusqu’aux dents, Andrei Tarkovski fait un film de guerre : d’une part la démonstration explicite du conflit, sa tension et sa froideur mais aussi et surtout, tout ce qui entoure le déploiement du combat. Et c’est là que le subjectif fait face à l’objectif, que les songes rencontrent la réalité. Non l’auteur ne jouit jamais d’une apparence spectaculaire dans son accoutrement. Ses effets, la mise en scène : tout est d’une grande humilité et d’une parfaite fluidité. La photographie est somptueuse, et dès son premier coup d’essai, Andrei Tarkovski démontre qu’il est un incroyable portraitiste, un peintre qui magnifie le contour des visages pour forger avec vigueur toute la teneur des expressions.
Mais qui dit temps de guerre, dit environnement hostile. Et afin de parfaire sa construction, Andrei Tarkovski dévoile sa plus grande qualité : celle d’esthète, d’un maitre qui n’a pas son pareil pour hypnotiser son auditoire par la désolation de ses paysages, le désœuvrement de ses plaines sèches de tout espoir. Prenant alors les allures d’un conte morbide, L’enfance d’Ivan garde une droiture, une rugosité dans l’émotion qui oblige le film, de lui-même, à garder une certaine distance avec son sujet. D’où la frontière assez paradoxale entre émerveillement et distance indifférente. Mais c’est sans compter sur la fin du film, qui offre une magie de mise en scène entre cette dichotomie entre les images qui suinte la mort des captifs sans la montrer et les voix de tortionnaires. Mais pouvait-il en être autrement ?
Critiques similaires
| Film: Enfance d'Ivan (L') Note: 7,5/10 Auteur: Val |
Film: Enfance d'Ivan (L') Note: 6,5/10 Auteur: Alegas |


-

Velvet - Batman

- Messages: 1710
- Inscription: Dim 16 Juin 2013, 17:34
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 1 invité
Founded by Zack_
Powered by phpBB © phpBB Group.
Designed by CoSa NoStrA DeSiGn and edited by osorojo and Tyseah
Traduction par phpBB-fr.com

Powered by phpBB © phpBB Group.
Designed by CoSa NoStrA DeSiGn and edited by osorojo and Tyseah
Traduction par phpBB-fr.com