| L'Enfant du Diable |
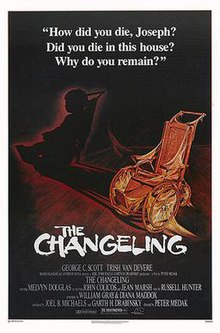 Titre original: The Changeling |
| 6,5/10 |
Le film se concentre sur John (George C. Scott) qui, après la perte de sa femme et sa fille, décide d'emménager dans une maison qui se révélera vite habitée par l'esprit d'un jeune garçon... Toute la première partie vise à nous faire partager le deuil dont est affligé John, que ce soit via la performance de George C. Scott qui joue avec justesse un homme effondré qui essaie de renouer avec la vie, ou parl'enchaînement d'amorces de séquences (on en voit juste le début, mais elles ne vont jamais jusqu'à leur terme) illustrées de manière quasi-ininterrompue par la très belle musique de Rick Wilkins et qui renvoient à la monotonie de son existence. Une réelle mélancolie se dégage du film, renforcée par les couleurs automnales voulues par le réalisateur.
 L'intrigue enchaîne ensuite avec la survenue de phénomènes paranormaux classiques (bruits venus d'on ne sait où, fenêtres brisées, balle surgie de nulle part, etc.). Peter Medak crée une atmosphère oppressante en multipliant les plans fixes sur des couloirs ou escaliers vides, les plans séquences à la steadycam, les plongées ou contre-plongées qui suggèrent la présence d'un esprit dans la bâtisse et mettent bien en valeur cette dernière. Medak adopte une approche plutôt terre-à-terre du fantastique, limitant ses effets pour enraciner son intrigue dans la vraisemblance, un peu à la manière de l'Exorciste quelques années plus tôt.
L'intrigue enchaîne ensuite avec la survenue de phénomènes paranormaux classiques (bruits venus d'on ne sait où, fenêtres brisées, balle surgie de nulle part, etc.). Peter Medak crée une atmosphère oppressante en multipliant les plans fixes sur des couloirs ou escaliers vides, les plans séquences à la steadycam, les plongées ou contre-plongées qui suggèrent la présence d'un esprit dans la bâtisse et mettent bien en valeur cette dernière. Medak adopte une approche plutôt terre-à-terre du fantastique, limitant ses effets pour enraciner son intrigue dans la vraisemblance, un peu à la manière de l'Exorciste quelques années plus tôt.Les films de maison hantée ayant tendance à tous se ressembler, le cinéaste va fort heureusement se focaliser sur l'enquête du personnage principal pour percer le mystère entourant ces phénomènes. Une enquête qui ira de séance de spiritisme en visites à la bibliothèque locale, en passant par une excavation dans un puits qui annonce une scène similaire dans le Ring de Hideo Nakata (un autre film sur un esprit d'enfant vengeur).
 Là où le bât blesse, c'est qu'on ne sent jamais vraiment le héros en danger. Une conséquence probable du nombre limité de victimes, mais aussi du choix de George C. Scott, qui même fragilisé dans son deuil dégage suffisamment de force et d'autorité pour faire face aux phénomènes auxquels il est confronté.
Là où le bât blesse, c'est qu'on ne sent jamais vraiment le héros en danger. Une conséquence probable du nombre limité de victimes, mais aussi du choix de George C. Scott, qui même fragilisé dans son deuil dégage suffisamment de force et d'autorité pour faire face aux phénomènes auxquels il est confronté.De plus, si le réalisateur réussit plusieurs séquences chocs (le bris du miroir et la transition avec la mort du flic, l'attaque de l'héroïne par le fauteuil roulant filmée en vue "subjective" ou l'apparition du gamin dans la baignoire), il manque au film de véritables séquences de flippe. Medak fait dans le suggéré, ce qui est une bonne chose, mais ne signe aucun gros morceau de trouille, aucune scène vraiment angoissante ou un tant soir peu marquante.
Des défauts qui desservent un film qui reste quand même tout à fait recommandable.





 Les scènes automobiles ne sont, en effet, qu'un prétexte pour décrire les chassés-croisés amoureux entre trois coureurs et leurs prétendantes, sur un ton léger pas éloigné des comédies romantiques tournées par le cinéaste. Les enjeux sont donc amoureux, et non pas sportifs, certains personnages se révélant aussi peu à l’aise dans leurs relations sentimentales qu’ils sont sûrs d'eux derrière un volant. Les quiproquos sentimentaux vont prendre par moments un tournant dramatique, notamment lors de la mort d'un coureur ou lorsque la jalousie d'un personnage va éclater sur le circuit.
Les scènes automobiles ne sont, en effet, qu'un prétexte pour décrire les chassés-croisés amoureux entre trois coureurs et leurs prétendantes, sur un ton léger pas éloigné des comédies romantiques tournées par le cinéaste. Les enjeux sont donc amoureux, et non pas sportifs, certains personnages se révélant aussi peu à l’aise dans leurs relations sentimentales qu’ils sont sûrs d'eux derrière un volant. Les quiproquos sentimentaux vont prendre par moments un tournant dramatique, notamment lors de la mort d'un coureur ou lorsque la jalousie d'un personnage va éclater sur le circuit.
 Si je lui reconnais un beau noir et blanc qui camoufle l'aspect un peu toc de certains décors et permet de créer une atmosphère gothique appréciable, le film souffre d'un côté théâtral et de scènes de trouille très peu mises en scène. Le film joue davantage sur la surprise que sur le suspense et, si ça fonctionne à une occasion (l'apparition soudaine de la domestique aveugle m'a fait sursauter), ça tombe bien souvent à plat.
Si je lui reconnais un beau noir et blanc qui camoufle l'aspect un peu toc de certains décors et permet de créer une atmosphère gothique appréciable, le film souffre d'un côté théâtral et de scènes de trouille très peu mises en scène. Le film joue davantage sur la surprise que sur le suspense et, si ça fonctionne à une occasion (l'apparition soudaine de la domestique aveugle m'a fait sursauter), ça tombe bien souvent à plat.



 D'ailleurs, le film démarre de manière déstabilisante avec de larges extraits de son film Un Homme et une femme, projeté à une assemblée de taulards dont fait partie Lino Ventura, avant d'enchaîner sur la sortie de prison d'un Ventura cherchant à joindre la femme qu'il aime (filmée en noir et blanc, et avec Mireille Mathieu en guest-star
D'ailleurs, le film démarre de manière déstabilisante avec de larges extraits de son film Un Homme et une femme, projeté à une assemblée de taulards dont fait partie Lino Ventura, avant d'enchaîner sur la sortie de prison d'un Ventura cherchant à joindre la femme qu'il aime (filmée en noir et blanc, et avec Mireille Mathieu en guest-star 
 Ce qui m'a frappé cette fois, c'est à quel point Batman est un personnage secondaire dans son propre film. Tout ce qui touche à la solitude du personnage est bien traité: l'introduction où Wayne est comme ramené à la vie à l’apparition du bat-signal, les tournées dans les rues désertes coincé dans le cockpit de la Batmobile, l'épilogue... Par contre, la dualité Bruce Wayne / Batman, que j’avais trouvé bien retranscrite dans le premier Batman, est peu mise en avant ici. Le personnage n’est quasiment pas développé et n'existe, grosso modo, que pour donner la réplique aux méchants.
Ce qui m'a frappé cette fois, c'est à quel point Batman est un personnage secondaire dans son propre film. Tout ce qui touche à la solitude du personnage est bien traité: l'introduction où Wayne est comme ramené à la vie à l’apparition du bat-signal, les tournées dans les rues désertes coincé dans le cockpit de la Batmobile, l'épilogue... Par contre, la dualité Bruce Wayne / Batman, que j’avais trouvé bien retranscrite dans le premier Batman, est peu mise en avant ici. Le personnage n’est quasiment pas développé et n'existe, grosso modo, que pour donner la réplique aux méchants. ). Danny De Vito restitue bien l’aspect à la fois tragique et répugnant de son personnage. Son sort final, avec les pingouins qui lui offrent des funérailles, se révèle émouvant, et détonne par rapport à ce que l’on peut attendre de ce genre de films, où la mort du bad guy est généralement source de réjouissance. Il n’y a que le personnage de Max Schreck qui me convainc moyennement: la prestation de Christopher Walken n’est pas en cause, mais il s’avère bien plus manichéen et moins haut en couleurs que les deux autres méchants.
). Danny De Vito restitue bien l’aspect à la fois tragique et répugnant de son personnage. Son sort final, avec les pingouins qui lui offrent des funérailles, se révèle émouvant, et détonne par rapport à ce que l’on peut attendre de ce genre de films, où la mort du bad guy est généralement source de réjouissance. Il n’y a que le personnage de Max Schreck qui me convainc moyennement: la prestation de Christopher Walken n’est pas en cause, mais il s’avère bien plus manichéen et moins haut en couleurs que les deux autres méchants. Les touches de cruauté et de sadisme (la torche humaine allumée par la Batmobile, le gros dispersé à l’aide d’une bombe, l’assistant qui se fait bouffer le nez par le Pingouin) ou les allusions sexuelles sont culottées pour un blockbuster censé casser la baraque au box-office. Le côté théâtral des combats, où les opposants continuent à se donner la réplique en se filant des coups de poings ou de pieds, fait très comic-book pour le coup. Par contre, sur toutes les autres séquences d’action, on sent on sent le réalisateur peu impliqué, traitant ces passages en mode automatique. Le scénario connaît quelques baisses de régime préjudiciables, avançant parfois péniblement jusqu’à un climax poussif.
Les touches de cruauté et de sadisme (la torche humaine allumée par la Batmobile, le gros dispersé à l’aide d’une bombe, l’assistant qui se fait bouffer le nez par le Pingouin) ou les allusions sexuelles sont culottées pour un blockbuster censé casser la baraque au box-office. Le côté théâtral des combats, où les opposants continuent à se donner la réplique en se filant des coups de poings ou de pieds, fait très comic-book pour le coup. Par contre, sur toutes les autres séquences d’action, on sent on sent le réalisateur peu impliqué, traitant ces passages en mode automatique. Le scénario connaît quelques baisses de régime préjudiciables, avançant parfois péniblement jusqu’à un climax poussif. 

 Tout d'abord, un
Tout d'abord, un 
 Si la première intrigue permet de créer un léger suspense sur le fait que les médecins s'aperçoivent à temps ou pas qu'il est vivant, l'enquête sur la disparition de la copine du bonhomme s'avère d'une extrême platitude. Pour un giallo, le film s'avère bien avare en séquences sanglantes et fait totalement l'impasse sur une quelconque esthétisation des meurtres, tous traités par-dessus la jambe. A la rigueur, pourquoi pas: un film comme Mais qu'avez-vous fait à Solange a prouvé qu'un giallo pouvait s'en passer, s'il possède en contrepartie une enquête prenante, ce qui n'est pas le cas ici.
Si la première intrigue permet de créer un léger suspense sur le fait que les médecins s'aperçoivent à temps ou pas qu'il est vivant, l'enquête sur la disparition de la copine du bonhomme s'avère d'une extrême platitude. Pour un giallo, le film s'avère bien avare en séquences sanglantes et fait totalement l'impasse sur une quelconque esthétisation des meurtres, tous traités par-dessus la jambe. A la rigueur, pourquoi pas: un film comme Mais qu'avez-vous fait à Solange a prouvé qu'un giallo pouvait s'en passer, s'il possède en contrepartie une enquête prenante, ce qui n'est pas le cas ici.  ) et, surtout, grâce à la fin-choc inattendue et qui clôt le film sur une image terrassante. C'est bien dommage que le reste n'ait pas été du même niveau!
) et, surtout, grâce à la fin-choc inattendue et qui clôt le film sur une image terrassante. C'est bien dommage que le reste n'ait pas été du même niveau!
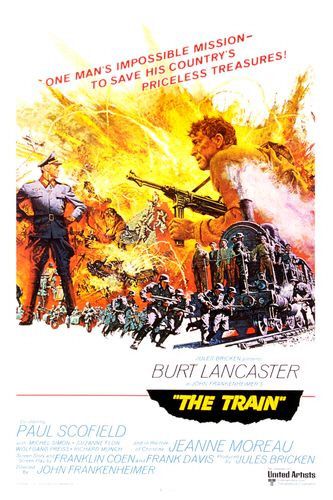
 Au casting, Burt Lancaster bouffe encore une fois l'écran. Paul Scofield, quant à lui, restitue bien l'ambivalence de son colonel allemand amateur d'Art qui n'hésite pas à faire fusiller de sang-froid des civils innocents. L'interprétation est d'un niveau très homogène pour un film mélangeant des acteurs de diverses nationalités (dont Howard Vernon, le docteur Orloff himself). Mais ça fait quand même bizarre d'entendre Suzanne Flon ou Michel Simon doublés en anglais alors qu'ils interprètent des personnages français et que l'intrigue se déroule intégralement en France!
Au casting, Burt Lancaster bouffe encore une fois l'écran. Paul Scofield, quant à lui, restitue bien l'ambivalence de son colonel allemand amateur d'Art qui n'hésite pas à faire fusiller de sang-froid des civils innocents. L'interprétation est d'un niveau très homogène pour un film mélangeant des acteurs de diverses nationalités (dont Howard Vernon, le docteur Orloff himself). Mais ça fait quand même bizarre d'entendre Suzanne Flon ou Michel Simon doublés en anglais alors qu'ils interprètent des personnages français et que l'intrigue se déroule intégralement en France!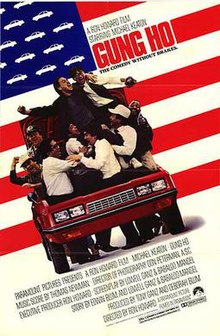
 Gung Ho bénéficie de l'abattage comique de Michael Keaton, qui excelle dans son rôle de syndicaliste dépassé par les événements qui, en tentant de sauver les meubles, va aggraver la situation. Il forme un joli duo avec Gedde Watanabe, chacun des personnages retrouvant chez l'autre la pression sociale que lui-même subit.
Gung Ho bénéficie de l'abattage comique de Michael Keaton, qui excelle dans son rôle de syndicaliste dépassé par les événements qui, en tentant de sauver les meubles, va aggraver la situation. Il forme un joli duo avec Gedde Watanabe, chacun des personnages retrouvant chez l'autre la pression sociale que lui-même subit.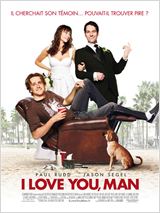
 Le film reprend la formule (et les acteurs) des comédies de Judd Appatow, avec son mélange de gags scato/vomi/cul (mais avec un nombre de "fuck" moins conséquent), l'emploi d'acteurs comiques dans les seconds rôles (Jon Favreau excellent en type complètement imbuvable et Andy Samberg qu'on voit tous les deux trop peu, ou Aziz Ansari qu'on voit déjà trop
Le film reprend la formule (et les acteurs) des comédies de Judd Appatow, avec son mélange de gags scato/vomi/cul (mais avec un nombre de "fuck" moins conséquent), l'emploi d'acteurs comiques dans les seconds rôles (Jon Favreau excellent en type complètement imbuvable et Andy Samberg qu'on voit tous les deux trop peu, ou Aziz Ansari qu'on voit déjà trop 