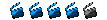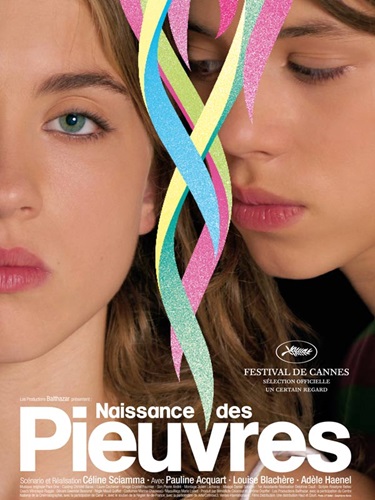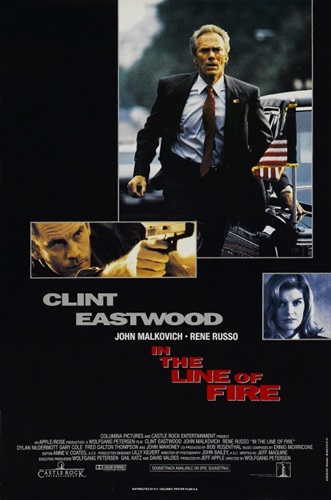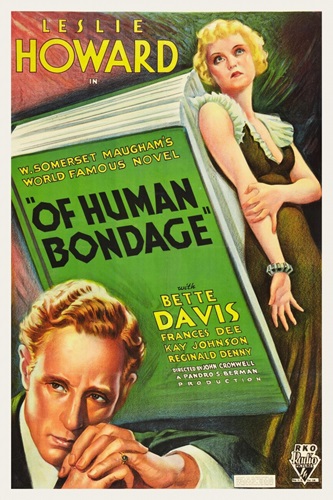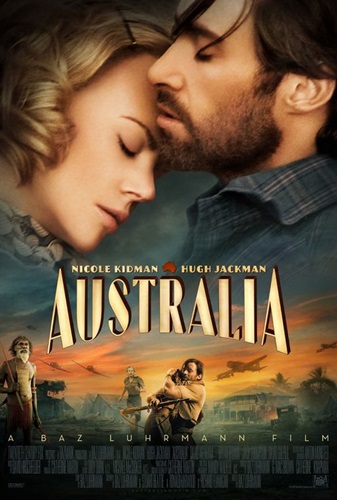Les glaneurs et la glaneuse de Agnès Varda
(2000)
(2000)
Dans ma critique des Cent et une nuits de Simon Cinéma, j’évoquais l’idée que le style de Varda siérait sans doute plus au documentaire qu’au film de fiction, et je suis content d’avoir découvert ce film car ça confirme complètement ma pensée. Sur le papier, on se demande vraiment ce que ça va pouvoir raconter, Varda s’intéressant aux glaneurs, donc aux personnes qui, après la récolte des fruits et légumes, ramassent ou cueillent ce qui reste. Et pourtant, d’un tout petit sujet, Varda en tire une œuvre assez passionnante qui non seulement va jusqu’au bout de son sujet, en évoquant l’historique de la pratique, ou encore sa législation en France (j’ignorais complètement qu’il y avait un droit à la récupération de la nourriture, même sur des propriétés privées), mais qui va aussi en tirer tout un portrait saisissant de la société moderne et de ses contradictions.
Ce qui fascine, c’est le fait que Varda saisit la moindre opportunité pour faire un pas de côté et ainsi livrer des portraits sincères d’hommes et de femmes du quotidien, ça va être soit une famille qui chope des pommes de terre invendues pour manger plus à leur faim, des personnes qui récupèrent les encombrants dans la rue, souvent pour prendre le cuivre, d’autres qui le font pour en faire des œuvres d’art, ou encore un homme intriguant qui est prof la nuit pour les nécessiteux, et qui, le jour, prends les restes des légumes du marché pour manger au jour le jour. De tout ça, Varda tire un film qui donne l’impression d’aller dans tous les sens, mais qui, étrangement, reste toujours cohérent avec sa note d’intention. On la sent passionnée par son sujet et les personnes qu’elle rencontre, et il y a en plus un côté ludique qui se rajoute avec l’aspect technologique, puisque c’est apparemment le premier film que Varda tourne à la caméra numérique, ce qui lui permet de jouer avec l’idée d’une caméra que l’on peut sortir à n’importe quel moment, même futile (les camions sur la nationale), ou que l’on peut laisser filmer par erreur tout en incorporant la scène au montage final. Pour le coup, c’est une vraie surprise de la part d’une réalisatrice qui n’avait jamais réussi à me convaincre jusqu’ici.
Ce qui fascine, c’est le fait que Varda saisit la moindre opportunité pour faire un pas de côté et ainsi livrer des portraits sincères d’hommes et de femmes du quotidien, ça va être soit une famille qui chope des pommes de terre invendues pour manger plus à leur faim, des personnes qui récupèrent les encombrants dans la rue, souvent pour prendre le cuivre, d’autres qui le font pour en faire des œuvres d’art, ou encore un homme intriguant qui est prof la nuit pour les nécessiteux, et qui, le jour, prends les restes des légumes du marché pour manger au jour le jour. De tout ça, Varda tire un film qui donne l’impression d’aller dans tous les sens, mais qui, étrangement, reste toujours cohérent avec sa note d’intention. On la sent passionnée par son sujet et les personnes qu’elle rencontre, et il y a en plus un côté ludique qui se rajoute avec l’aspect technologique, puisque c’est apparemment le premier film que Varda tourne à la caméra numérique, ce qui lui permet de jouer avec l’idée d’une caméra que l’on peut sortir à n’importe quel moment, même futile (les camions sur la nationale), ou que l’on peut laisser filmer par erreur tout en incorporant la scène au montage final. Pour le coup, c’est une vraie surprise de la part d’une réalisatrice qui n’avait jamais réussi à me convaincre jusqu’ici.
7/10





 . Je ne sais plus qui m’avait conseillé ce film, prétextant que c’était très différent des actioners habituels de Liam Neeson, et que ça ne se prenait pas au sérieux. Alors oui, on est très loin du premier degré des productions dans lesquelles l’acteur s’engage depuis une quinzaine d’années, mais le fait de ne pas se prendre au sérieux ne veut pas dire non plus qu’il faut faire de la merde sous prétexte que c’est drôle. Pour le coup, il y a peu de choses que je trouve un tant soit peu réussies dans ce film, qui me donne l’impression qu’un mec a découvert
. Je ne sais plus qui m’avait conseillé ce film, prétextant que c’était très différent des actioners habituels de Liam Neeson, et que ça ne se prenait pas au sérieux. Alors oui, on est très loin du premier degré des productions dans lesquelles l’acteur s’engage depuis une quinzaine d’années, mais le fait de ne pas se prendre au sérieux ne veut pas dire non plus qu’il faut faire de la merde sous prétexte que c’est drôle. Pour le coup, il y a peu de choses que je trouve un tant soit peu réussies dans ce film, qui me donne l’impression qu’un mec a découvert 

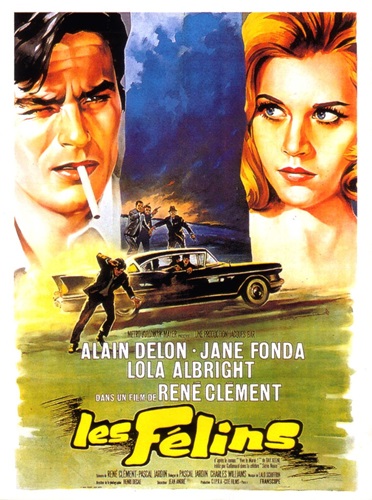

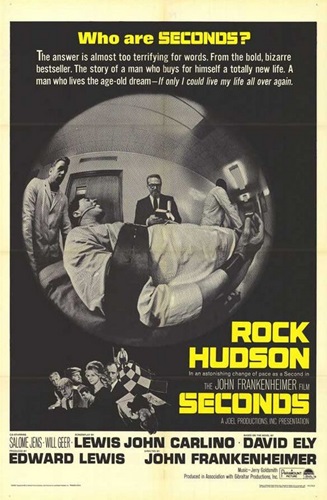
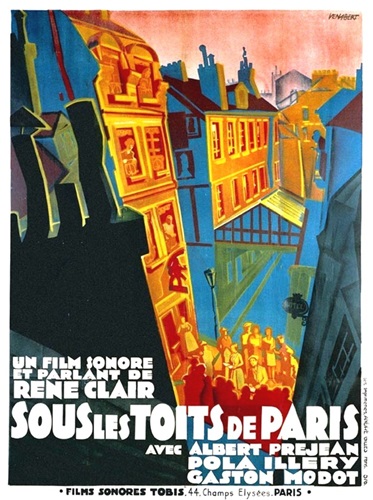

 ), la direction artistique dans l’ensemble est très cool, et puis il y a ces maquillages encore impressionnants plus de vingt ans après, ok ils sont un peu rigides et empêchent les singes d’avoir toutes les expressions nécessaires (on comprend pourquoi la performance capture a été privilégiée plus tard), mais le boulot est tout de même dingue. Clairement un film qui est l’exemple même de ce qui arrive quand on conçoit un blockbuster sans un script finalisé, et où on précipite toutes les étapes de la production. Il n’y avait peut-être pas matière à un grand film, mais nul doute qu’il aurait pu être meilleur avec peu de choses.
), la direction artistique dans l’ensemble est très cool, et puis il y a ces maquillages encore impressionnants plus de vingt ans après, ok ils sont un peu rigides et empêchent les singes d’avoir toutes les expressions nécessaires (on comprend pourquoi la performance capture a été privilégiée plus tard), mais le boulot est tout de même dingue. Clairement un film qui est l’exemple même de ce qui arrive quand on conçoit un blockbuster sans un script finalisé, et où on précipite toutes les étapes de la production. Il n’y avait peut-être pas matière à un grand film, mais nul doute qu’il aurait pu être meilleur avec peu de choses.