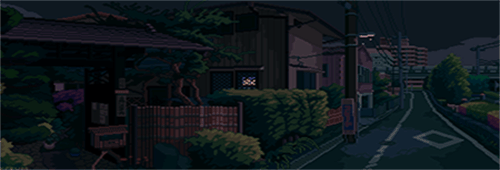Solaris
Andrei Tarkovski - 1972
En voyant coup sur coup Stalker et Solaris, on se dit que Tarkovski aimait beaucoup les tunnels. Tunnels humides et bétonnés dans Stalker, tunnels dans le périphérique d’Akasaka à Tokyo ou tunnel futuriste de la station spatiale dans Solaris. Après, était-il bien utile de pousser la passion jusqu’aux tunnels de dialogues ? C’est l’un des défauts dont on pourrait faire grief au réalisateur russe, connu pour avoir la dent dure envers ses collègues cinéastes, qu’ils se nomment Ozu, Antonioni, Polanski, Bertollucci, Antonioni, Fellini, Bunuel, ou même Kubrick. Pour ce dernier, c’est connu, il détestait son 2001, jugeant que le film manquait de « force émotionnelle », notamment à cause de l’attention trop marquée sur les avancées technologiques.
Le souci, c’est que l’on ne peut pas dire que son film soit traversé par une émotion qui va serrer la gorge de son spectateur. J’avais vu Solaris une première fois il y a bien vingt ans, et j’en avais gardé le souvenir d’un film froid. Revisionné hier, le verdict ne change pas. Pourtant, l’histoire d’amour entre le scientifique Kris Kelvin et sa femme Khari, ou plutôt une reproduction de sa femme, l’océan qui recouvre la planète Solaris ayant le pouvoir de pénétrer les êtres pour matérialiser leurs souvenirs (la femme de Kris étant morte depuis dix ans), était prometteuse. Un amour retrouvé, mais aussi un amour perdu, impossible, le clone de Khari souffrant de ne pas avoir d’identité propre tandis que kelvin devient peu à peu aliéné à son passé. Belle histoire ma foi, mais qui me touche moins finalement que les larmes de Bowman quand il déconnecte HAL (assez remarquable que la seule émotion marquée dans 2001 ait pour cadre une opération informatique). La faute au jeu des acteurs (ou à leur direction par Tarkovski, c’est selon) qui ne parvient jamais à faire vibrer de leur désespoir, mais aussi aux tunnels de dialogues évoqués. Kubrick avait conçu 2001 comme une expérience non verbale, et y était parvenu tant le film se rapproche d’une certaine manière des films muets. On pourrait imaginer une version qui virerait les dialogues pour les remplacer par une dizaine de panneaux, ça fonctionnerait. Tarkovski, lui, a préféré contrer avec un film « supra-verbale ». Dans l’espace, personne ne vous entend crier, disait l’autre. Ben, chez Tarkovski, on vous entend jacter. Et sur deux heures quarante-cinq, c’est un peu dur à la longue.
Quant à sa critique concernant l’attention sur les avancées technologiques, là aussi ça semble un poil incohérent. Kubrick ayant pour objectif de faire un film S-F adulte avec pour projet rien moins que de raconter l’évolution de l’humanité, et connaissant son perfectionnisme, on n’attendait pas spécialement une représentation du futur faite de bric et de broc, avec des costumes à la monsieur Spock. Après, pour parvenir au résultat que l’on sait, il a fallu des moyens et des talents dans tous les domaines de la production (décors, costumes et effets spéciaux notamment), association prodigieuse de forces vives créatrices que le Russe n’avait pas à disposition. Du coup, je me demande si la remarque de Tarkovski n’était pas le fait d’un aigri cherchant à camoufler cette incapacité en brandissant l’argument du mépris envers les tours de force visuels de Kubrick (la station spatiale, les scènes en apesanteur, Bowman qui s’éjecte sans casque de sa capsule – scène qui avait donné lieu à l’époque à de vifs débats entre scientifiques pour déterminer si c’était plausible ou non – etc.). Parce que bon, concernant Solaris, on ne peut pas dire que le rendu futuriste soit bien impressionnant. Quand Kelvin fait sortir le premier clone de sa femme via une petite fusée, on écarquille les yeux devant la pauvreté du rendu de la scène. Le couloir circulaire de la station est assez sympa, mais les portes en métal grossier et fixées sur des gonds invitent moins au rêve. Finalement, je crois que j’ai préféré la première partie du film, quand Kelvin est en pleine campagne dans la maison de son père. Tarkovski et la nature, ça me semble plus prometteur que Tarkovski et les étoiles (là aussi, l’unique plan stellaire du film est à pleurer).
Après, je ne doute pas que le film est intelligent, mais la double barrière de la profusion des dialogues et d’un aspect visuel pas toujours heureux ont fait qu’il n’y a pas eu fascination et que, contrairement à l’expérience que m’a procuré Stalker (film avec lequel Solaris a des points communs : trois hommes, un espace invitant à un questionnement douloureux…), je ne me suis pas senti d’humeur à interpréter.
Prochaine étape tarkovskienne : Le Miroir.