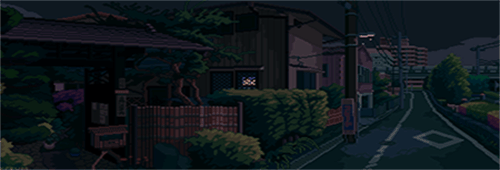Les Contes de la lune vague après la pluie (Ugetsu)
Kenji Mizoguchi - 1953
Tout vient à point à qui sait attendre. J’ai longtemps tourné autour d’
Ugetsu, à la fois tenté et méfiant, redoutant de me retrouver face à une histoire au rythme lent, figée dans un univers traditionnel un peu poussiéreux. J’ai finalement lancé le visionnage hier (un peu téméraire d’ailleurs de le faire juste après La Femme des Sables, il peut être bon d’espacer les gros chefs-d’œuvre : j’avais encore l’esprit hanté par les sonorités de Takemitsu, la vision du corps dénudé de Kyôko Kishida et celle bien sûr des paysages de sable), et je ne l’ai pas regretté.
D’abord parce qu’il n’y avait nul statisme. Le titre français, l’indique, il s’agit d’un conte, pas d’un récit avec une approche romanesque. Dès lors la narration vise-t-elle à la plus grande efficacité. Treize minutes suffisent à Mizoguchi pour nous rendre familiers des cinq protagonistes (deux familles de villageois, dont l’une avec un enfant). Genjûrô est un potier acharné, non par souci de perfection, mais parce qu’il est saisi par le démon de la cupidité. Il aime sa femme, Miyagi, et c’est réciproque, mais cette dernière se contenterait bien d’une vie plus simple, pas aussi obsédée par l’argent (précisons que nous sommes dans un contexte de guerre et que son mari prend des risques pour se rendre à la ville). Sinon le potier est un mari et un père affectueux, mais là aussi, un détail suffit pour faire comprendre que cette affection est parasitée par la fièvre de l’or, dans cette scène où Genjûrô, concentré sur la confection d’une poterie, rembarre son fils sous prétexte qu’il le dérange. Il a sinon un beau-frère, Tôbei, qui a lui aussi une obsession : devenir coûte que coûte samouraï, ce qui bien sûr ne lasse pas d’inquiéter sa femme, la belle Ohama. Violemment rejeté par des soldats à qui il proposait ses services, il n’a d’autre choix d’accompagner Genjurô à la ville pour l’aider à vendre ses poteries. Et comme ils en reviennent assez riches, le voilà lui aussi atteint par la cupidité. Malheureusement, tous leurs plans sont à revoir avec l’irruption dans le village d’une armée ennemie…
Voilà, tout cela, Mizoguchi le raconte en moins d’un quart d’heure, sans pour autant que le spectateur ait une sensation d’empressement. Et cela continue tout le long de l’heure et demie. Il y a un dynamisme, une fluidité narrative propres au conte qui fait qu’à aucun moment on ne s’ennuie. Rien de superflu, pas de bout de gras, chaque scène est là pour enrichir le côté initiatique du voyage que vont entreprendre les personnages. Et rien de didactique, Mizoguchi préférant faire réfléchir par la voie royale de la poésie. Quelque chose m’a saisi dès la première scène, scène dans laquelle on entre dans le film par un mouvement panoramique (de la droite vers la gauche) faisant découvrir un paysage rural avant que la petite famille n’entre dans le champ, affairée à mettre des poteries dans une charrette. Rien de plus simple, mais associée à la musique traditionnelle de Fumio Hamasaka, parfaitement composée (cf. le détail du haut du crâne de l’enfant qui dépasse de la charrette et qui permet aussitôt de faire comprendre que l’on se trouve face à une famille), la vision charme et projette le spectateur vers ces trois-là qu’il a envie de connaître et d’aimer.
Magnifique aussi ce passage plus tard où, après avoir rencontré une sorte d’avatar de Calypso en la personne de dame Wakasa, femme ensorceleuse, Genjûrô oublie Miyagi et fait l’amour avec Wakasa dans le bassin d’un onsen. Rien de montré bien entendu, là aussi un mouvement de caméra qui, pudiquement, file vers la gauche, montre les abords caillouteux (et forcément humides pour jouer du symbole) du bassin puis, par un discret fondu, d’enchaîner avec une zone herbeuse où se trouvent, en plein jour, Genjurô et Wakasa en train de batifoler. La faute du potier est consommée, le voilà devenu amant de Wakasa. Dix secondes suffisent pour le faire comprendre, avec à la fin une sublime composition picturale.
Et sublime aussi est la fin du conte. J’ai évoqué Calypso, c’est vrai qu’il y a un peu d’une Odyssée dans cette histoire. Genjûrô retrouvera-t-il sa Pénélope et son Télémaque ? Il sortira des griffes de Wakasa, tandis que Tôbei, découvrant l’inanité et l’absurdité de la voie des armes (il est parvenu à devenir samouraï mais par le biais d’un moyen lâche, lui aussi voit sa pureté entamée), il retrouve par hasard sa compagne devenue prostituée par sa faute et décide de rentrer avec elle au village pour retrouver sa vie originelle. Et, sans dévoiler la dernière surprise du récit, disons simplement que le film se clôt par un autre panoramique, mais cette fois-ci de la gauche vers la droite, suivant un personnage, le voyant à la fin du déplacement exécuter une action simple, émouvante, avant que la caméra ne s’élève pour faire apparaître le paysage présent au tout premier plan du film, le tout nimbé de musique gagaku, la musique traditionnelle la plus élevée, celle que l’on réservait à la cour de l’empereur. Après leurs frasques, leurs erreurs, leurs taches, voilà les personnages ont tous été purifiés et, en dépit de leur basse condition, accèdent à une sorte de pureté, de grandeur et d’élégance tandis que le spectateur, lui, regarde tout cela avec des yeux ronds comme les soucoupes fabriquées par le potier, avec ce petit frisson particulier que seules les maîtresses œuvres savent procurer.
Oui, tout vient à point à qui sait attendre. Toujours agréable de découvrir sur le tard de telles œuvres.