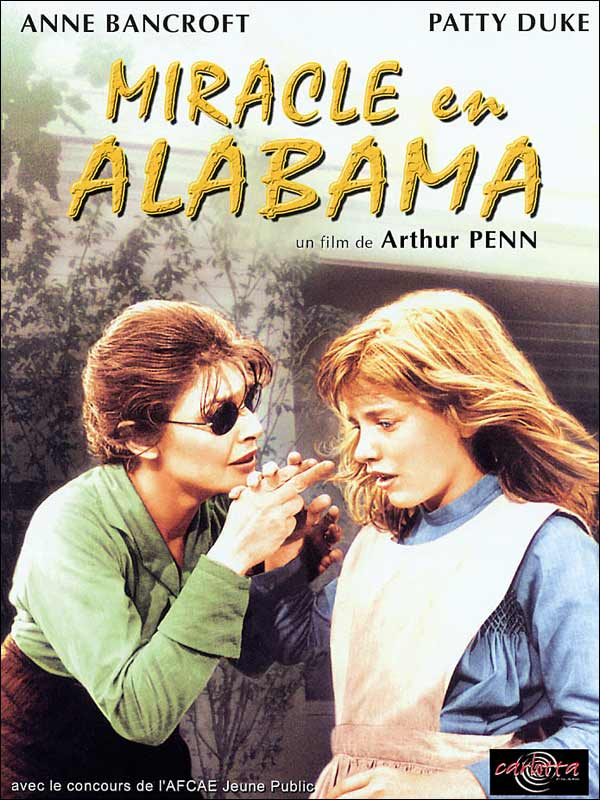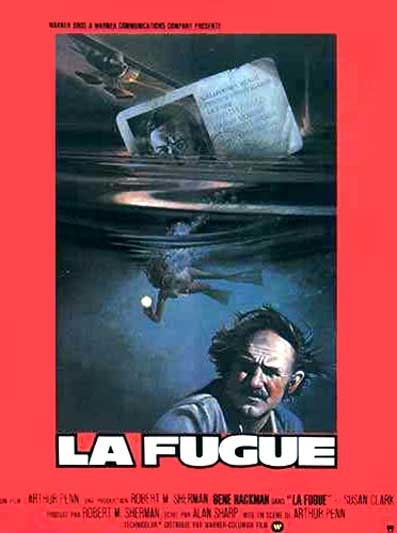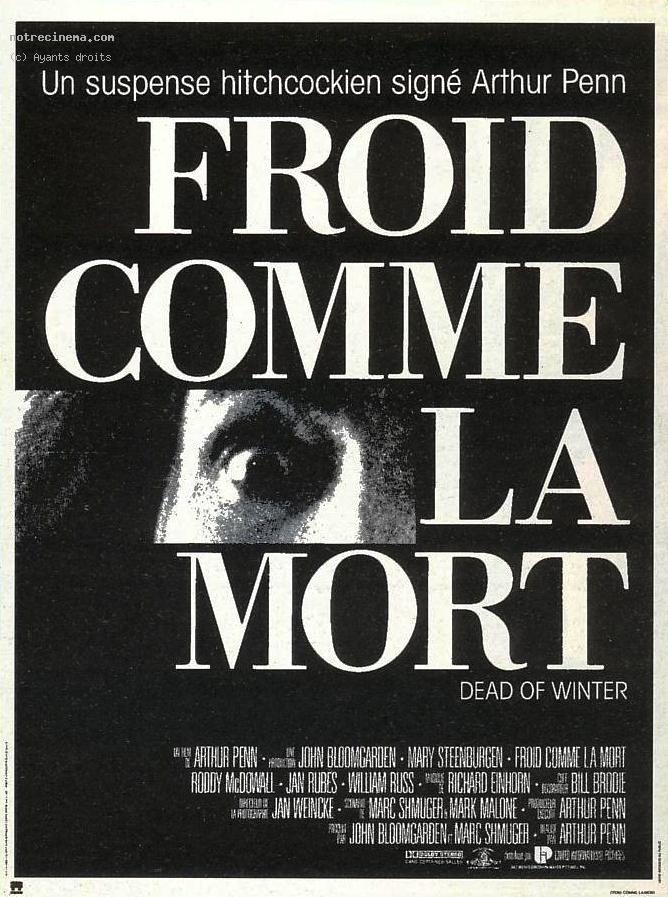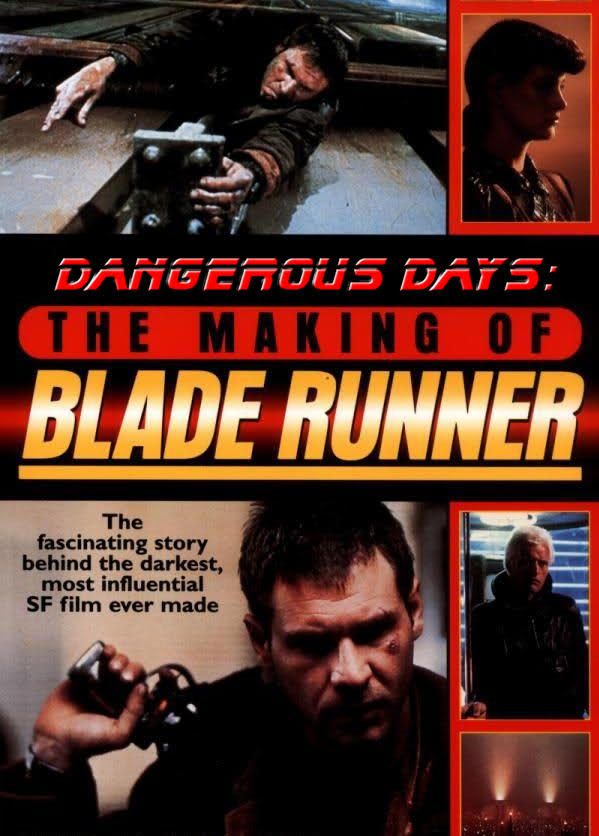Robin Blood.
Il est particulièrement intéressant de constater que l’un des films séminaux du Nouvel Hollywood ne prend pas à bras le corps son époque, mais un passé traumatique, celui de la Grande Dépression. Période trouble déjà magnifiée par Ford dans Les Raisins de la Colère, et ici l’objet d’une investigation nouvelle : il ne s’agit plus de déplorer le sort des victimes, mais d’illustrer la réaction possible face à l’adversité : la réponse à une violence (économique) par une autre : criminelle.
Bonnie & Clyde fit beaucoup parler de lui en son temps pour cette représentation frontale, mêlant glamour, érotisme et meurtres. Nouveau-né de l’ère post code Hays, on y découvre des symboles phalliques explicites, une jeune fille dévergondée et des impacts sanglants sur les corps, dans une furie que la mise en scène restitue avec vigueur : cuts, ralentis, montage frénétique permettent à Penn une déclaration d’indépendance sur tous les fronts.
Il serait pourtant réducteur de s’arrêter à l’audace de la forme ; car si le film semble épouser la cause de ses personnages par son goût de la provocation, il se révèle bien plus subtil dans le traitement des hors-la-loi. Certes, leur statut inspire la sympathie, à la lumière de la séquence permettant aux expropriés de cribler de balles les panneaux des banques. S’ils ne vont pas jusqu’à réactiver la geste d’un Robin des bois, les gangsters clament haut et fort le militantisme de leur action, contribuant à leur légende qui les accompagne. Sur ce point, le fil est tiré avec la célébrité qui enivrait déjà Billy the Kid dans Le Gaucher : le hors la loi fascine, il venge les opprimés.
Pourtant, les deux protagonistes sont loin d’incarner un idéal héroïque. Le glamour de Faye Dunaway n’occulte pas son inconscience, voire son attrait malsain pour la violence (qui reprend un peu des traits de la psychopathe de gun Crazy) ; plus original encore, l’impuissance de Clyde et leurs échecs sexuels écornent leur aura, une habitude chez Warren Beatty qui, comme dans John McCabe par exemple, prend plaisir à démythifier les figures de légende. L’idéalisation n’est pas de mise : non seulement, la violence repousse, mais la communauté qui se forge autour du couple ne fonctionne pas. On retrouve le pessimisme de Penn, aussi à l’œuvre dans La Poursuite impitoyable ou Little Big Man : la collectivité est malade, et la cohabitation impossible. Les conflits avec la belle-sœur, les trahisons, et les adieux à la mère jouent sur cette partition complexe et instable. La scène de kidnapping du croque mort est en cela éloquente : de la violence au dilettantisme, elle semble un temps mettre en place une bulle utopique avant que le rappel de la mort ne fasse voler en éclat les illusions.
Road movie, Bonnie & Clyde est surtout le trajet d’une fuite en avant : c’est la mélancolie d’un adieu au monde, et le sourire juvénile qui se crispe avant de s’effacer. Abattus comme des lapins, les amants braqueurs ne sont ni des martyres, ni des ennemis publics : ils disent avec toute l’ambiguïté possible la nouvelle ère d’un cinéma qui s’intéresse aux figures troubles et à la façon dont le système les ingère, ou les expulse.