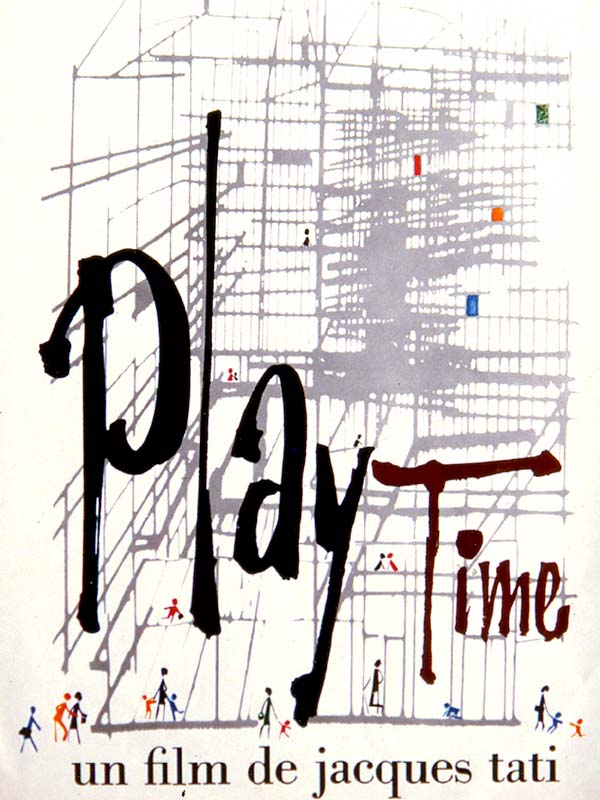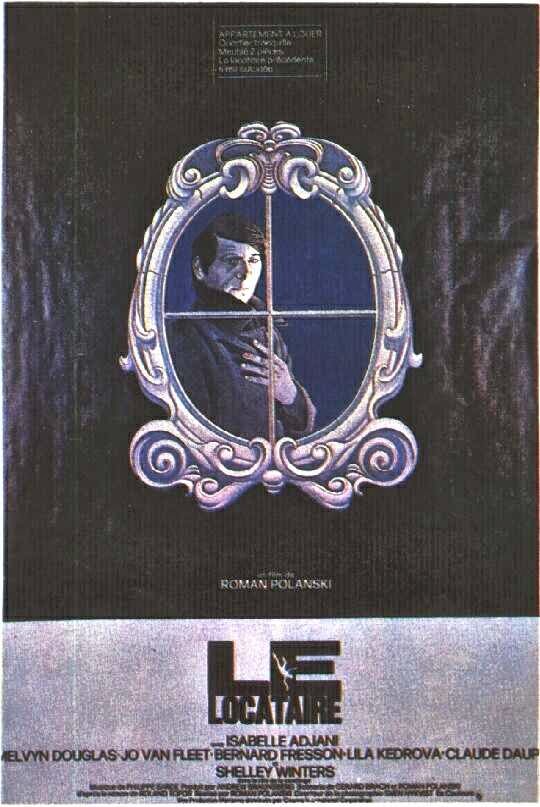Fargo - 8,5/10

Vertiges de la lose
Fargo, c’est avant tout une ligne droite, cette saignée grisâtre dans la neige qui trace avec une mélancolie infinie une direction unique, aussi tragique que pathétique.
Les protagonistes ont beau faire tous les détours possibles, comme William H. Macy par ses circonvolutions sur un parking ou les branquignoles qu’il emploie dans leurs échanges atones : rien n’y fait, la linéarité demeure, magnifiée par des plans larges ou des plongées oppressantes, qu’on retrouvait déjà dans la claustrophobie de Barton Fink. Petites silhouettes perdues au milieu d’enjeux minables, parce que si profondément à la hauteur de la médiocrité humaine, les protagonistes se perdent dans la neige comme d’autres erraient en forêt dans Miller’s Crossing.
Pour que rien ne fonctionne et qu’on se délecte avec un léger malaise de cette entreprise de déconstruction, il faut que tout fonctionne, et c’est bien là l’une des immenses qualités de ce film : rendre palpable cette lose infinie d’un protagoniste enferré dans les sables mouvants de sa médiocrité, et que chaque initiative enfonce davantage. Autour de lui, quelque soit le côté de l’échiquier, c’est l’erreur de jugement qui domine, des petits notables de province désireux de faire justice eux-mêmes, de l’épouse au Q.I d’un pied de chaise qu’on ferait mieux de laisser kidnappée à ses ravisseurs, truculents Peter Stormare & Steve Buscemi, entre mutisme sociopathe et logorrhée nerveuse.
Chez les bouseux du Minnesota, le polar est malmené. Les attendus scènes de climax, du rapt aux rançons, des poursuites, au fusillades, tout est désactivé par la maladresse généralisée et l’incapcatié chronique des personnages à être à la hauteur du genre dans lequel ils s’illustrent. Mais à la différence des maladresses de Burn After Reading où la bêtise tournait à la caricature un peu vaine, le personnage de Frances McDormand change la donne, instaurant un équilibre précaire, entre authenticité et satire, entre quête de la vérité et médiocrité du quotidien, simplicité et vanité de tous ces formidables interrogatoires où l’on s’applique à parler pour ne rien dire, comme ce trait distinctif qu’on accorde au personnage de Buscemi :
- Kinda funny lookin’
- In what way ?
- Oh, just in a general kinda way.
Au-delà de l’enquête, c’est donc un portrait qui surgit : celui d’une femme dont la simplicité désarmante contrebalance la noirceur du monde, qui porte la vie en elle et sait se réjouir de ce qu’on croit dans un premier temps méprisable au même titre que le reste. De cette drôlerie féroce, de ce regard porté avec la même fixité que sur les meurtres et les échecs, le spectateur tire dans la séquence finale un sentiment d’autant plus étonnant qu’il était inattendu : une empathie, embarrassée, mais bien réelle. Ou comment dépasser le simple cynisme par un contrepoint humain et donner une épaisseur autrement plus intéressante à la simple farce cruelle. C’est bien là ce qui habite la plupart des films des frères Coen, qui ont souvent su équilibrer cette lucidité sur l’homme et la compréhension à l’égard de sa triste condition, particulièrement dans A serious Man ou le magnifique Inside Llewyn Davis, et que la phrase qui clôt l’enquête par McDormand résume de façon imparable :
“I just don’t understand”.