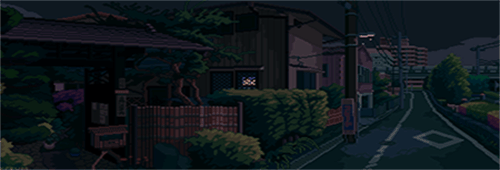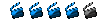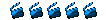Le Locataire
Roman Polanski - 1976
Brillante conclusion à la trilogie dite « de l’appartement », brillant film fantastique, brillant film semi-autobiographique et enfin, bien avant
Le Pianiste, brillant film sur la Shoah. Quatre ans avant la sortie de Shining, Polanski adapte un roman de Topor de manière très fidèle (pour l’avoir lu, j’avais l’impression d’avoir le story-board du film entre les mains) mais en saupoudrant l’ensemble d’ingrédients permettant de s’approprier l’histoire et de la présenter au spectateur de manière à présenter plusieurs angles interprétatifs, le plus captivant étant celui rattaché à la propre histoire de Polanski, ce Juif polonais qui a dans son enfance connu le ghetto de Cracovie.
Car quelle autre situation connait son personnage dans ce hideux appartement d’un immeuble parisien dans lequel il n’est pas vraiment le bienvenu ? Certes, il est libre de sortir, d’aller où bon lui semble, de draguer une jolie fille comme Stella, de se rendre avec elle au cinoche pour la peloter, etc. Mais à y regarder de plus près, cette liberté a tout de la liberté de façade. Assez vite, les occupants de l’immeuble lui font comprendre une chose : il a intérêt à filer doux, à ne pas faire de bruit… voire à s’effacer.
Ainsi voilà Trelkovsky qui, après pas mal de courbettes et de compromissions pour mettre la main sur cet appartement qui a tout du taudis insalubre, va aller jusqu’à ne plus recevoir chez lui pour ne pas faire de bruit. Personnaliser son appartement, bouger les meubles pour un meilleur aménagement ? À ses risques et périls, aussitôt le voisin du dessus, au moindre crissement sur le parquet, va donner des coups au plafond pour faire comprendre que c’en est trop. Avec à la clé la menace, notamment par Monsieur Zy, le propriétaire, de « prendre des mesures ». Habilement, Polanski ne fait pas dire au vieil homme en quoi consisteraient ces mesures. Le spectateur comprend qu’il s’agit de se plaindre pour tapage auprès du commissariat. Mais contextualisé avec ce Juif cherchant à se fondre dans la masse, on pourrait y voir une hideuse dénonciation.
En tout cas la situation devient de plus en plus compliquée pour Trelkovsky. Accusé sans raison, rejeté, il n’a de cesse d’essayer de se faire accepter en prouvant qu’il ne fait pas de vagues. De manière plus insidieuse, on essaye de lui faire perdre son identité, en lui faisant prendre celle de la précédente occupante de l’appartement, Simone Choule, occupante qui est morte suite à une défénestration (motif qui réapparaîtra d’ailleurs dans
Le Pianiste, avec les nazis balançant par la fenêtre un vieux Juif). Toutefois un doute subsiste : « on » lui fait perdre son identité ou est-ce lui qui, un début de folie aidant, s’imagine qu’il vaut mieux être une autre pour se faire accepter ? Et quand le patron du petit bar en face de son immeuble lui propose à chaque fois une tasse de chocolat et un paquet de Marlboro (à la place de Gauloises) qui correspondaient aux goûts de Simone Choule, est-ce un malencontreux hasard ou Trelkovsky a-t-il bien raison d’imaginer qu’il s’agit d’un complot délirant pour le forcer à effacer son identité pour se plier à de nouvelles normes ? Rarement le cinéma a illustré avec autant de brio le doute fantastique tel que Todorov l’a défini dans son fameux essai sur le genre.


Dans tous les cas, sa liberté devient de plus en plus fragile, et le sentiment d’être surveillé plus intense. Dans la rue, on aperçoit plusieurs fois ces affiches publicitaires avec ce slogan, « La Peinture Lure », où l’on voit trois hommes de face, grossièrement peints et semblant épier les passants façon Big Brother (on songe aussi à des affiches de propagandes de la Seconde Guerre Mondiale). Même dans la rue, Trelkovsky est (/se sent) surveillé. Fricoter avec une belle française de souche comme Stella, la peloter au cinéma ? Aussitôt il sent le poids du regard des autres, comme si cela lui était désormais interdit. La dépossession et la réclusion deviennent si intenses que l’on n’est pas surpris de le voir chez lui affublé d’un pyjama rayé qui évoque fortement la tenue des prisonniers juifs dans les camps. Quant aux toilettes de son immeuble située tout au bout d’un couloir, avec les kyrielles d’inscriptions gravées aux murs (parmi lesquelles on remarque une étoile qui qui n’est pas exactement l’étoile de David, mais difficile de ne pas y penser), elles ont tout du dérisoire échappatoire carcéral (Trelkovsky est surpris de voir de sa fenêtre que, la nuit, des personnes s’y rendent pour y rester immobiles des heures durant) où l’on peut y crier tranquillement sa détresse.
Lors d’une brillante scène hallucinatoire où le personnage, pris de fièvre, s’y rend, on le voit revenir ensuite chez lui. Dans sa chambre, les meubles ont l’avoir d’avoir triplé de volume, comme s’ils étaient devenus trop lourds, trop importants pour lui, l’insignifiant, le néfaste Trelkosvsky que tout le monde cherche à pousser au suicide. Un peu plus tard, on le voit au jardin du Luxembourg assis sur une chaise, au milieu d’autres, vides par contre, près du bassin où des gosses ont l’habitude de faire flotter des navires. On songe ici aux chaises commémoratives de la place Bohaterów, à Cracovie (monument d’ailleurs attribué à tort sur certains sites à Polanski). Certes, le monument a été créé bien après Le Locataire, mais il n’est pas farfelu de voir en Trelkovsky assis dehors, en plein hiver, sur une modeste chaise, en train de regarder un insupportable garçon français petit bourgeois, une réminiscence de ces juifs dépossédés de tout. Et les chaises vides autour de lui seraient comme le signe que, loin d’être le seul, il serait au contraire une énième victime de ce complot aux accents kafkaïens.
À la fin, la boucle est bouclée. Prise seulement au niveau du genre du fantastique, elle présente un vertigineux effet de poupée gigogne. Sur le plan symbolique et historique, elle rappelle juste que, pour les Juifs, il n’y a aucun échappatoire, l’histoire est souvent un éternel recommencement.



 ) tombe par hasard sur lui dans une rue, en train de faire… le camelot.
) tombe par hasard sur lui dans une rue, en train de faire… le camelot.